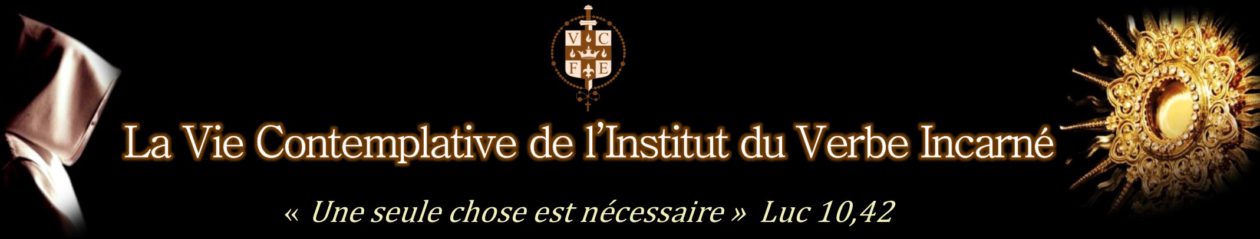Pourquoi l’Église catholique n’accepte-t-elle pas l’ordination sacerdotale des femmes ?
N’est-ce pas une discrimination que certaines confessions comme l’anglicanisme ont déjà surmontée ? L’attitude du Christ ne devrait-elle pas être comprise, peut-être, comme typique de son temps et déjà révolue ?
Réponse:
Le problème de l’admission des femmes au sacerdoce ministériel est l’un des problèmes les plus brûlants dans les pays de tradition anglicane et où les auteurs du progressisme catholique ont eu ou ont une force particulière. Ainsi, par exemple, E. Schillebeeckx O.P. dit : ‘…Les femmes… n’ont aucune autorité, aucune juridiction. C’est de la discrimination… L’exclusion des femmes du ministère est une question purement culturelle qui n’a plus de sens aujourd’hui. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas présider l’Eucharistie ? Pourquoi ne peuvent-elles pas être ordonnées ? Il n’y a pas d’arguments pour s’opposer au sacerdoce des femmes… En ce sens, je suis heureux de la décision [de l’Église anglicane] de conférer le sacerdoce aussi aux femmes, et, à mon avis, c’est une grande ouverture pour l’œcuménisme, plutôt qu’un obstacle, car beaucoup de catholiques vont dans le même sens »[1].
Au contraire, le magistère catholique a fermement et invariablement maintenu le déni de la possibilité d’ordination féminine, et ce dans des documents définitifs[2]. Quelle est la raison ultime pour laquelle les femmes ne peuvent pas accéder au sacerdoce ministériel ?
1. De la tradition
Le Magistère fait appel à la Tradition, entendue non pas comme ‘ancienne coutume’ mais comme garantie de la volonté du Christ quant à l’essentiel de la constitution de son Église (et des sacrements). Cette Tradition se reflète en trois choses : l’attitude du Christ, de ses disciples et de la tradition. Voyons chacune de ses choses, en soulignant également les principales objections qui sont généralement soulevées à cet égard.
1) L’attitude de Jésus-Christ.

Historiquement, Jésus-Christ n’a appelé aucune femme à faire partie des douze. Il faut y voir une volonté explicite, puisqu’Il pouvait le faire et manifester ainsi sa volonté. Jésus-Christ devait prévoir qu’en prenant l’attitude qu’il adoptait, ses disciples l’interpréteraient comme telle, sa volonté.
Objection : L’objection la plus courante est que Jésus-Christ a agi ainsi pour se conformer aux coutumes de son temps et de son milieu (le judaïsme) dans lequel les femmes n’exerçaient pas d’activités sacerdotales.
Réponse : Précisément à l’égard de la femme, Jésus-Christ n’a pas respecté les coutumes du milieu juif. Parmi les juifs rigides, les femmes subissaient certainement une grave discrimination dès leur naissance, qui s’est ensuite étendue à la vie politique et religieuse de la nation. « Malheur à celui dont les descendants sont des femelles !», dit le Talmud. La naissance d’une fille provoquait tristesse et agacement ; une fois grandie, elle n’avait pas accès à l’apprentissage de la Loi. La Mishna dit : “Que les paroles de la Torah (Loi) soient détruites par le feu plutôt que de l’enseigner aux femmes… Celui qui enseigne la Torah à sa fille est comme lui enseigner les calamités ». Les femmes juives manquaient souvent de droits, étant considérées comme des objets en possession des hommes. Un Juif récitait quotidiennement cette prière : « Béni soit Dieu qui ne m’a pas fait païen ; béni soit Dieu qui n’a pas fait de moi femme ; béni soit Dieu qui ne m’a pas fait esclave’.
Pour cette raison, l’attitude de Jésus envers les femmes contraste fortement avec celle des juifs contemporains, au point que ses apôtres s’émerveillaient et s’étonnaient de son traitement à leur égard (cf. Jn 4, 27). Ainsi :
-Il s’entretient publiquement avec la Samaritaine (cf. Jn 4,27)
-Il ne tient pas compte de l’impureté légale de l’hémorroïsse (cf. Mt 9,20-22)
– Il permet à une pècheresse de s’approcher de lui dans la maison de Simon le pharisien et même de le toucher pour lui laver les pieds (cf. Lc 7,37)
– Il pardonne à la femme adultère, montrant ainsi qu’on ne peut pas être plus sévère avec le péché d’une femme qu’avec celui d’un homme (cf. Jn 8,11)
– Il s’éloigne de la Loi mosaïque pour affirmer l’égalité des droits et des devoirs de l’homme et de la femme par rapport au lien conjugal (cf. Mt 19,3-9 ; Mc 10,2-11).
– Il est accompagné et soutenu dans son ministère itinérant par des femmes (cf. Lc 8,2-3)

– Il leur confie le premier message pascal, Il annonce même sa Résurrection aux Onze à travers elles (cf. Mt 28,7-10 et parallèles).
Cette liberté d’esprit et cette distance sont évidentes pour montrer que si Jésus-Christ voulait l’ordination ministérielle des femmes, les coutumes de son peuple ne représentaient pas pour lui un obstacle.
2) Attitude des Apôtres.
Les apôtres ont suivi la pratique de Jésus concernant le ministère sacerdotal, n’y appelant que des hommes. Et cela malgré le fait que Marie la Très Sainte occupait une place centrale dans la communauté des premiers disciples (cf. Act 1,14). Quand ils doivent remplacer Judas, ils choisissent entre deux hommes.
Objection 1 : On peut donner la même objection faite : les apôtres suivaient aussi les coutumes de leur temps.
Réponse : L’objection a moins de valeur que dans le cas précédent, car dès que les Apôtres et saint Paul ont quitté le monde juif, ils ont été contraints de rompre avec les pratiques mosaïques, comme on le voit dans les discussions pauliniennes avec les Juifs. Or, à moins qu’elles n’aient été claires sur la volonté du Christ, le nouvel environnement dans lequel ils ont commencé à vivre les aurait conduites au sacerdoce féminin, puisque dans le monde hellénistique de nombreux cultes païens étaient confiés à des prêtresses.
Leur attitude ne saurait non plus être due à la méfiance ou au mépris des femmes, puisque les Actes apostoliques montrent avec quelle confiance saint Paul demande, accepte et apprécie la collaboration des femmes notables :
-Il les salue avec gratitude et loue leur courage et leur miséricorde (cf. Rm 16,3-12; Ph 4,3)

-Priscille achève la formation d’Apollon (cf. Ac 18,26)
-Phèbe est au service de l’église de Cencre (cf. Rm 16,1)
-D’autres sont citées avec admiration comme Lydie, etc.
Mais saint Paul fait une distinction dans le même langage :
-Quand il parle indistinctement d’hommes et de femmes, il les appelle ‘mes collaborateurs’ (cf. Rm 16,3; Ph 4,2-3)
-Quand il parle d’Apollon, de Timothée et de lui-même, il parle de ‘coopérateurs de Dieu’ (cf. 1 Co 3,9; 1 Th 3,2).
Objection 2 : Les dispositions apostoliques et surtout pauliniennes sont claires, mais ce sont des dispositions déjà caduques, comme d’autres, par exemple : l’obligation pour les femmes de porter le voile sur la tête (cf. 1 Co 11,2 -6) , ne pas parler en assemblée (cf. 1 Co 14,34-35; 1 Tm 2,12), etc.
Réponse : Comme on le voit, le premier cas (le voile féminin) concerne des pratiques disciplinaires de peu d’importance, tandis que l’admission au sacerdoce ministériel ne peut être rangée dans la même catégorie. Dans le deuxième exemple, il ne s’agit nullement de « parler », car saint Paul lui-même reconnaît aux femmes le don de prophétiser dans l’assemblée (cf. 1 Co 11,5) ; l’interdiction se réfère à la « fonction officielle d’enseigner dans l’assemblée chrétienne », qui n’a pas changé, car en tant que telle, elle ne concerne que l’évêque.
3) Attitude des Pères, la Liturgie et le Magistère.
Lorsque certaines sectes gnostiques hérétiques des premiers siècles ont voulu confier le ministère sacerdotal à des femmes, les Pères ont jugé une telle attitude inacceptable dans l’Église. Surtout dans les documents canoniques de la tradition antiochienne et égyptienne, cette attitude est indiquée comme une obligation de rester fidèle au ministère ordonné par le Christ et scrupuleusement conservé par les apôtres [3].
2. A la lumière de la théologie sacramentelle

L’argumentation centrale est celle développée précédemment ; nous pouvons cependant accéder à une autre voie argumentative qui rend plus évident que la tradition qui remonte au Christ n’est pas une simple disposition disciplinaire mais qu’elle a une base ontologique, c’est-à-dire qu’elle est basée sur la structure même de l’Église et le sacrement de l’Ordre. Les deux arguments que nous donnons ci-dessous font appel au symbolisme sacramentel.
1) Le sacerdoce ministériel est un signe sacramentel du Christ Prêtre.
Le prêtre ministériel, surtout dans son acte central qu’est le Sacrifice eucharistique, est un signe du Christ Prêtre et Victime. Or, la femme n’est pas un signe adéquat du Christ Prêtre et Victime, c’est pourquoi elle ne peut pas être prêtre ministériel.
En effet, les signes sacramentels ne sont pas purement conventionnels. L’économie sacramentelle est fondée sur des signes naturels qui représentent ou signifient par une ressemblance naturelle : ainsi le pain et le vin pour l’Eucharistie sont des signes adéquats parce qu’ils représentent la nourriture fondamentale des hommes, l’eau pour le baptême parce qu’elle est le moyen naturel de purification et de lavage. etc. Ceci est valable non seulement pour les choses mais aussi pour les personnes. Donc, si dans l’Eucharistie il est nécessaire d’exprimer sacramentellement le rôle du Christ, il ne peut y avoir de « ressemblance naturelle » entre le Christ et son ministre que si ce rôle est joué par un homme [4].
En effet, l’Incarnation du Verbe s’est faite selon le sexe masculin. C’est une question, en effet, qui fait rapport avec toute la théologie de la création dans la Genèse (la relation entre Adam et Eve ; Christ comme le nouvel Adam, etc.) et que si quelqu’un n’est pas d’accord avec elle ou avec son interprétation, en tout cas, il est confronté au fait indéniable de la masculinité du Verbe Incarné. Si l’on veut, on doit donc discuter pourquoi Dieu s’est incarné dans un homme et non dans une femme ; mais du fait que c’était le cas, on ne peut que soutenir que seul un homme représente adéquatement l’homme-Christ.
Objection 1 : L’objection des anglicans enclins à l’ordination féminine est que, selon eux, l’essentiel de l’incarnation n’est pas que le Christ soit devenu homme mais qu’il soit devenu « être humain ». Ce n’est donc pas tant l’homme qui représente adéquatement le Christ, mais « l’être humain » en tant que tel.
Réponse : Le problème de l’objection consiste en une conception insuffisante de ce qu’on appelle, en théologie sacramentelle, « représentation adéquate ». Les signes sacramentels doivent garder une représentation adéquate, c’est-à-dire la plus spécifique possible. De ce point de vue, « l’être humain » (homme-femme) est une représentation adéquate du Christ mais dans son sacerdoce commun (le sacerdoce commun des fidèles), non du Christ dans son sacerdoce ministériel de la Nouvelle Alliance. L’« être humain » représente adéquatement le Verbe fait chair, mais ne représente que génériquement et vaguement le Christ prêtre. En fait, le caractère sacerdotal (ministériel) est une sous-spécification du caractère chrétien général qui est donné à chaque homme (homme et femme) par le baptême.
Objection 2 : Le Christ est maintenant dans la condition céleste, c’est pourquoi il est indifférent qu’il soit représenté par un homme ou une femme, car ” À la résurrection, on ne prend ni femme ni mari” (Mt 22,30).
Réponse : Ce texte (Mt 22,30) ne signifie pas que la glorification des corps supprime la distinction sexuelle, car celle-ci fait partie de l’identité propre de la personne. La distinction des sexes et, par conséquent, la sexualité propre à chacun est la volonté primordiale de Dieu : « homme et femme il les créa » (Gn 1,27).
2) Le symbolisme nuptial.

Le Christ est présenté dans la Sainte Écriture comme l’Époux de l’Église. En effet, en Lui se réalisent toutes les images nuptiales de l’Ancien Testament qui se réfèrent à Dieu comme Époux de son peuple Israël (cf. Os 1-3 ; Jr 2, etc.). Cette caractérisation est constante dans le Nouveau Testament :
-chez Saint Paul : 2 Co 11,2 ; Ep 5,22-33
– chez Saint Jean : Jn 3,29 ; Rév 19,7.9
-dans les Synoptiques : Mc 2,19 ; Mt 22,1-14
Or, cela met en lumière le rôle masculin du Christ par rapport au rôle féminin de l’Église en général. Donc, de sorte que pour que dans le symbolisme sacramentel le sujet qui agit comme matière du sacrement de l’Ordre (représentant le Christ), puis le sujet qui agit comme ministre de l’Eucharistie (agissant « in persona Christi ») soit un signe adéquat doit être un mâle.
Objection : Le prêtre représente aussi l’Église, qui a un rôle passif par rapport au Christ. Alors, la femme peut représenter adéquatement l’Église ; alors elle peut aussi être prêtre.
Réponse : Il est vrai que le prêtre représente aussi l’Église et que cela pourrait être assuré par une femme. Mais le problème est qu’il ne représente pas seulement l’Église mais aussi le Christ et que, pour tout ce que nous avons dit, une femme ne peut pas le représenter. Donc, l’homme peut représenter les deux aspects, mais la femme un seul, qui n’est pas proprement sacerdotal.
3.Conclusion

Les principaux bogues tournent autour de deux problèmes. Le premier est de ne pas concevoir adéquatement le sacerdoce sacramentel, en le confondant avec le sacerdoce commun des fidèles. Le second est de se laisser emporter par les préjugés qui voient dans le sacerdoce ministériel une discrimination à l’égard des femmes et, en même temps, une exaltation des hommes au détriment des femmes ; c’est un manque d’optique : dans l’Église catholique, le sacerdoce ministériel est un service au Peuple de Dieu et non une affaire aristocratique ; de plus, ce dernier est précisément un abus du sacerdoce ministériel, semblable à celui qui a contaminé le pharisaïsme et le saducéisme des temps évangéliques. Enfin, les plus grands dans le Royaume des Cieux ne sont pas les ministres mais les saints ; et – à l’exclusion de l’humanité du Christ – la plus haute des créatures en honneur et en sainteté, la Vierge Marie, n’a été investie par Dieu d’aucun caractère sacerdotal.
Père Miguel A. Fuentes, IVE
Traduction de l’article en espagnol
[1] E. Schillebeeckx O.P., « Je suis un théologien heureux ». Entretien avec F. Strazzati, Société d’éducation d’Athènes, Madrid 1994, pp. 117-118.
[2] Deux documents ont explicitement abordé le sujet : Instruction de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Inter insigniores, la question de l’admission des femmes au sacerdoce ministériel, 15 octobre 1976. Enchiridion Vaticanum, Volume 5 ( 1974-1976), n° 2110-2147 ; Lettre apostolique de Jean-Paul II, 22 mai 1994. A laquelle il faut ajouter : Card. Ratzinger « Ordinatio Sacerdotalis , Réponse au doute sur la doctrine de la Lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis », 28 octobre 1995.
[3] Cf. Inter insigniores, nº 2115.
[4] Inter insigniores, n° 2134.