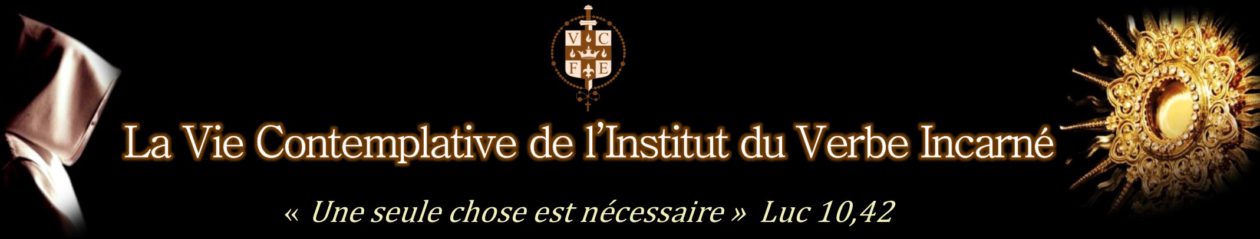Dimanche de la Sainte Famille. Année C
Il y a une caractéristique chez la Sainte Famille présente dans toutes les lectures de cette Fête, dans les trois Cycles, c’est un seul mot : obéissance. Le Christ, dont nous célébrons la naissance, est venu dans le monde pour faire la volonté du Père et une telle obéissance, docile à l’inspiration de l’Esprit Saint, doit trouver donc une place dans chaque famille chrétienne.

L’obéissance est aussi présente évidement chez la Vierge Marie et saint Joseph ; ainsi, ce dernier obéit à l’ange et conduit le Fils et sa Mère en Égypte (année A) ; Marie et Joseph obéissent à la Loi en présentant l’Enfant au Temple (Année B) et en se rendant à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive (année C). Jésus, pour sa part, obéit à ses parents terrestres mais le désir d’être dans la maison du Père est encore plus grand (Année C) .
Le verbe grec que Saint Luc utilise en 2,51 pour dire que Jésus « était soumis » à Joseph et Marie est « hypotasse ». Le verbe tásso signifie « ordonner », « établir » ; hypó est une préposition qui signifie “sous”, qui peut être exprimé en français avec le préfixe « sub ». Par conséquent, le sens premier de hypotasso est « être subordonné à ». Cela implique fondamentalement deux choses. La première, être en état permanent de subordination et sujétion. La seconde, l’obéissance concrète à des commandements particuliers.
Mais l’évangile de ce dimanche nous offre aussi les premiers mots que les évangiles mettent dans la bouche de Jésus et qui nous montrent une profonde conscience de soi même ; ce sont des paroles qui séparent Jésus de toute dépendance humaine et le mettent au-dessus de tout intelligence limitée, des mots qui indiquent déjà la direction de sa vie. Jésus connaît déjà sa vocation sur le seuil de sa jeunesse. Ce n’est pas sans raison que le récit se situe entre les deux mentions de la sagesse de Jésus (Luc 2 : 40,52) ; Jésus a la sagesse parce qu’il est le Fils de Dieu. « Le juste prétend avoir la science de Dieu et être appelé le fils du Seigneur »(Sab_2 : 13).
Nous pouvons dire que Jésus « avait subordonné son jugement, sa décision et sa propre affection » à ceux de Joseph et Marie. En ce sens, Jésus était « soumis » à ses parents. Cependant, n’oublions pas qu’avant de dire que Jésus était subordonné à ses parents terrestres, saint Luc raconte l’événement de la perte de l’Enfant au Temple ce que, précisément, nous lisons dans l’Évangile d’aujourd’hui.

Dans ce cas, il y a une tension qui n’est pas si facile à dénouer. À première vue, cela ressemble à une espèce de désobéissance de Jésus à ses parents terrestres. Cependant, Jésus lui-même défend son innocence et affirme que c’est un acte d’obéissance à notre Père céleste. Jésus répond par une double question : « « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »?” (Lc 2,49). Ce « ne saviez-vous pas… ? » implique un aimable reproche. Cela signifie (dit très gentiment) : “Tu aurais dû savoir…” Saint Jean-Paul II dit qu’en posant cette question, Jésus fait référence à la prophétie que Siméon a faite à la Vierge Marie : “Une épée transpercera ton âme” (Lc 2,35). En fin de compte, la phrase de Jésus signifie : « Comme vous le savez, Je dois obéir à mon Père céleste avant vous ; Je dois être subordonné et soumis à mon Père Céleste avant tout. Et cela provoquera une grande épreuve dans ton âme et, par conséquent, une grande douleur ».
En définitive, Jésus est complètement subordonné à l’autorité qui est sur Lui, mais hiérarchiquement d’abord à Dieu ; ensuite aux hommes.
«« Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Par cette expression, Jésus se réfère au temple. Jésus doit être dans les choses qui appartiennent à son Père. Le temple est consacré à Dieu, Dieu y est présent. Considérons aussi que Jésus appelle Dieu « Père ou plutôt « Papa » dans sa langue maternelle « Abba ». C’est l’expression par laquelle les jeunes enfants appelaient leur père charnel. Plus tard aussi, Jésus conservera cette désignation de Dieu. Il y a un besoin qui apparaît souvent dans la vie de Jésus, qui préside à son action (4,43), qui le conduit à la souffrance et à la mort et donc à sa gloire (9:22; 17:25). Ce besoin a sa raison d’être dans la volonté de Dieu consignée dans l’Écriture Sainte, volonté qu’il suit inconditionnellement.
Jésus doit être dans les choses de son Père. Il se réfère au temple, mais ne le mentionne pas. Avec sa venue, l’ancien temple perd sa place dans l’histoire du salut. Un nouveau temple vient prendre sa place ; le temple est là où a lieu la communion du Père et du Fils: « les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité » (Jn. 4,23) .
La Mission des Parents Chrétiens
En ce jour, où nous célébrons la sainte Famille et nous méditons sur la mission des parents de Jésus, nous parlerons un peu du rôle des parents chrétiens, suivant le Catéchisme de l’Eglise Catholique (n. 2221 ss.)

La fécondité de l’amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants, mais doit s’étendre à leur éducation morale et à leur formation spirituelle. ” Le rôle des parents dans l’éducation est d’une telle importance qu’il est presque impossible de les remplacer ” (GE 3). Le droit et le devoir d’éducation sont pour les parents primordiaux et inaliénables (cf. FC 36).
Les parents doivent regarder leurs enfants comme des enfants de Dieu et les respecter comme des personnes humaines. Ils éduquent leurs enfants à accomplir la loi de Dieu, en se montrant eux-mêmes obéissants à la volonté du Père des Cieux.
Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Ils témoignent de cette responsabilité d’abord par la création d’un foyer, où la tendresse, le pardon, le respect, la fidélité et le service désintéressé sont de règle. Le foyer est un lieu approprié à l’éducation des vertus. Celle-ci requiert l’apprentissage de l’abnégation, d’un sain jugement, de la maîtrise de soi, conditions de toute liberté véritable. C’est une grave responsabilité pour les parents de donner de bons exemples à leurs enfants. En sachant reconnaître devant eux leurs propres défauts, ils seront mieux à même de les guider et de les corriger : ” Qui aime son fils lui prodigue des verges, qui corrige son fils en tirera profit ” (Si 30, 1-2). ” Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, élevez-les au contraire en les corrigeant et avertissant selon le Seigneur ” (Ep 6, 4).
Les parents enseigneront aux enfants à se garder des compromissions et des dégradations qui menacent les sociétés humaines.
Par la grâce du sacrement de mariage, les parents ont reçu la responsabilité et le privilège d’évangéliser leurs enfants. L’éducation à la foi par les parents doit commencer dès la plus tendre enfance. Elle se donne déjà quand les membres de la famille s’aident à grandir dans la foi par le témoignage d’une vie chrétienne en accord avec l’Evangile. Les parents ont la mission d’apprendre à leurs enfants à prier et à découvrir leur vocation d’enfants de Dieu (cf. LG 11).

Les enfants à leur tour contribuent à la croissance de leurs parents dans la sainteté (cf. GS 48, § 4). Tous et chacun s’accorderont généreusement et sans se lasser les pardons mutuels exigés par les offenses, les querelles, les injustices et les abandons. L’affection mutuelle le suggère. La charité du Christ le demande (cf. Mt 18, 21-22 ; Lc 17, 4).
Premiers responsables de l’éducation de leurs enfants, les parents ont le droit de choisir pour eux une école qui correspond à leurs propres convictions. Ce droit est fondamental. Les parents ont, autant que possible, le devoir de choisir les écoles qui les assisteront au mieux dans leur tâche d’éducateurs chrétiens (cf. GE 6). Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit des parents et d’assurer les conditions réelles de son exercice.

En devenant adultes, les enfants ont le devoir et le droit de choisir leur profession et leur état de vie. Ils assumeront ces nouvelles responsabilités dans la relation confiante à leurs parents dont ils demanderont et recevront volontiers les avis et les conseils. Les parents veilleront à ne contraindre leurs enfants ni dans le choix d’une profession, ni dans celui d’un conjoint. Ce devoir de réserve ne leur interdit pas, bien au contraire, de les aider par des avis judicieux, particulièrement lorsque ceux-ci envisagent de fonder un foyer.
Que la Sainte Famille bénisse toutes la familles de ce monde.
P. Luis Martinez IVE.