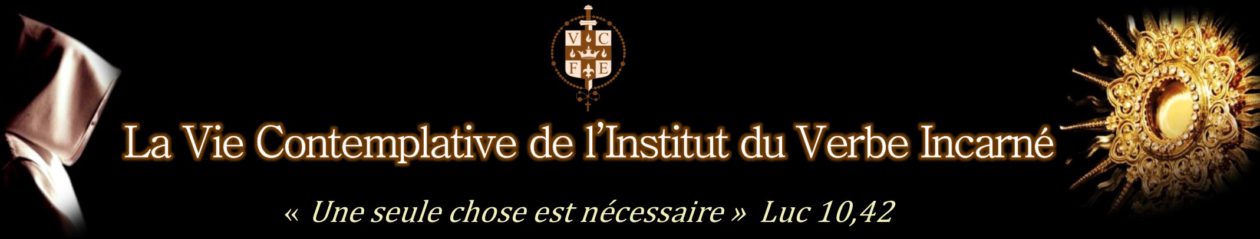CHARLES DE FOUCAULD ET SON ESPRIT MISSIONAIRE
Nous avons la grâce de célébrer dans ce jour le bx. Charles de Foucauld, patron de notre monastère.
Dans la vie du bienheureux Charles, comme dans la vie de tous les saints, la conversion ou le retour à l’amour de Dieu marque une grande nouvelle étape, il vivra désormais pour Jésus de Nazareth, cela sera son unique but, le chercher, le connaître, vivre en sa présence.
On peut dire que le moment de sa conversion se produit dans l’année 1886, entre le 27 et le 30 octobre, il n’en a jamais trop parlé dans ses lettres, on le connaît par les témoignages de sa famille. Il est intéressant aussi de savoir que la même année, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Lisieux reçoit elle aussi la grâce de Noël, une conversion « spéciale », la grâce de ne chercher que la sainteté.
Dieu préparait sa conversion beaucoup plus avant, depuis qu’il était explorateur dans le Maroc, où il a vu naître de désir de connaître Dieu, et cette étrange prière : « Mon Dieu, si tu existes, fais que te connaisse ». Quelques jours avant de revenir totalement à la vie chrétienne, il avait exprimé son angoisse à sa cousine : « vous êtes heureuse de croire ; je cherche la lumière et je ne la trouve pas »

Jusqu’à ce que le jour arrive où il s’est décidé « d’avoir la foi », mais sa façon de vouloir cela était très humaine, il pensait que la seule instruction pouvait lui donner la grâce de croire : « Monsieur l’abbé, je n’ai pas la foi, je viens vous demander de m’instruire » avait-il dit devant le confessionnal où il s’était juste penché, devant père Huvelin celui qui sera après son père spirituel. La réponse du prêtre l’étonne : « Mettez-vous à genoux confessez-vous et vous croirez ». « Mais je ne suis pas venu pour cela », « confessez-vous ».
Et ce qu’il pensait recevoir à travers une simple instruction, il l’a eu à travers un regard sincère de sa vie devant ce Dieu qu’il aimait mais qu’il ne connaissait pas encore.
Combien de fois il est bon pour nous de nous rappeler que notre religion ne s’agit pas d’une connaissance intellectuelle, théorique, nous ne sommes pas la religion d’un livre, mais celle d’une Personne, Jésus-Christ, nous ne pouvons pas non plus faire de notre religion un simple système de lois et règles, une méthode à appliquer pour la réussite. Elle a évidemment tous ces moyens mais ils ne servent à rien s’il ne se produit pas cette rencontre authentique avec Jésus de Nazareth.

S’il faut chercher un sens à toute la vie de missionnaire de Charles de Foucauld, nous pouvons dire qu’il s’agit de cette rencontre avec le Christ, une connaissance fondée sur l’amour et l’imitation de l’aimé, connaître et faire connaître le Dieu qu’il aimait : « j’ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth crucifié il y a mille neuf cent ans et je passe ma vie à chercher à l’imiter autant que le peut ma faiblesse. ».
Il y a quelques années, le pape Benoît XVI s’adressait à tous les catholiques avec ces paroles : « Évangéliser, c’est porter à d’autres la Bonne Nouvelle du salut et cette Bonne Nouvelle est une personne : Jésus-Christ. Quand je le rencontre, quand je découvre à quel point je suis aimé par Dieu et sauvé par lui, alors naît en moi non seulement le désir, mais la nécessité de le faire connaître à d’autres. » Ces paroles peuvent être très bien celles de notre patron, c’est ce qu’il disait avec d’autres mots, mais surtout il le disait avec sa vie.
Ce n’est pas un goût personnel, ou bien parce qu’il connaissait déjà le terrain qui l’amène à choisir le lieu de sa mission, c’est plutôt le désir de faire connaître le Christ à ceux qui sont encore dans l’ignorance.
Le Nord d’Afrique, Maroc avec dix mille habitants, pas un seul prêtre, le Sahara 7 fois grand que la France, juste une douzaine de missionnaire.

Alors, Comment affronter toute cette œuvre ? Il n’est pas fou, il est un homme de foi, il sait que ce n’est pas ses forces, ce n’est pas lui-même, sinon Dieu celui qui travaille, qui devance dans l’action missionnaire, qui prépare, qui fait grandir le désir de se faire connaître.
C’est pour cela que le Christ présent dans l’Eucharistie est le premier des missionnaires, le plus important, celui qui fait tout le travail. Comme lorsque Charles de Foucauld arrive en Algérie, dans les garnisons où n’est jamais passé un prêtre auparavant, il se réjouit de savoir que c’est pour la première fois que Jésus descend dans ce lieu, parce qu’il est fort probable qu’il n’y a jamais été corporellement.
On parlait tout à l’heure aussi de la cohérence de la vie avec la parole (l’exemple et la prédication), c’était un autre trait essentiel dans la vie de ce missionnaire. Pour les indigènes, desquels il avait gagné le respect depuis son arrivée, il n’était pas seulement le « marabout blanc », qui faisait le bien, qui les aidait, mais sa vie était quelque chose d’admirable grâce à sa sainteté et au détachement qu’il vivait des choses matérielles : pour eux, il était « celui qui avait vendu ce monde pour l’autre ».
Son ermitage exprimait tout seul son désir missionnaire, comme le montraient les écriteaux qu’il avait mis sur les murs, « Toi, suis-moi », « je suis venu porter le feu sur la terre », « Tout ce que vous faites à un de ces petits, vous me le faites » et aussi « j’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amène ». Comme on peut voir, pas d’ambiguïté dans le but de sa mission, s’il fallait conquérir les âmes par l’amitié c’était pour qu’elles trouvent le Bien avec majuscule, le bien suprême, mais c’est Dieu qui dirait quand et comment.

Il cherchait par tous les moyens de faire connaître Jésus, sa vie, son enseignement, sans imposer avec coaction sa foi à personne, parce qu’il était convaincu comme nous devons l’être aussi que la vérité n’impose pas, elle seule contient la force nécessaire pour conquérir, elle s’impose par elle-même ! Il n’avait aucune contrainte de présenter l’évangile à ceux qui venaient l’entendre ; il choisit de l’évangile d’abord ce qui pourrait mieux attendrir les âmes, la charité, l’humilité, la fraternité, le pardon des injures, le mépris de la richesse. En fait, il faut le dire, c’est le Sermon de la Montagne que le Père de Foucauld a répété toute sa vie aux musulmans.
Une autre note de sa vie comme missionnaire, il ne s’enfermait pas dans son petit Kiosque, il allait vraiment aux périphéries de ce monde. Il voulait que toute l’Afrique reçoive la bonne nouvelle et il s’en intéressait énormément, cela nous montrent ses écrits. Il se préoccupe de l’abandon de la foi des européens et le mal que cela causait aux différentes colonies, de la France, par exemple. Des chrétiens persécutés au moyen orient, de l’Eglise tout entière, mais non pas avec la critique sinon plutôt avec beaucoup de douleur et tout à fait conscient que le premier moyen pour aider le monde c’était la prière, l’adoration devant le Seigneur dans le silence et la solitude de son ermitage.
Lui, il était venu au Nord d’Afrique pour les indigènes, les plus abandonnés. Le père Charles s’occupait d’eux, mais il y avait une autre présence, celle des militaires français dispersés par tout le territoire. Comment les ignorer ? Comment ne pas faire quelque chose pour eux aussi ? Sans complexe, sans fausse dialectique il les reçoit dans son monastère, une lecture de l’évangile, un petit commentaire, une simple prière et la bénédiction. Combien de ces chrétiens s’étaient approchés des sacrements grâce à lui? Seulement Dieu le sait, mais il était là pour eux aussi.
Il offre aussi son cœur à ces soldat qui loin de leur famille, étaient touchés d’une amitié comme celle-ci. Voici une lettre écrite par le frère Charles à l’un d’eux :

« Cher ami, vous m’avez dit que vous êtes triste le soir… voulez-vous, si c’est permis de sortir du camp, venir passer habituellement les soirées avec moi… nous causerons fraternellement de l’avenir… de ce que vous désirez, espérez… A défaut du reste, vous trouverez ici un cœur fraternel… Le pauvre vous offre ce qu’il a. Ce qu’il vous offre surtout, c’est sa très tendre, très fraternelle affection, son profond dévouement dans le Cœur de Jésus. »
Demandons au bienheureux Charles de Foucauld la grâce de l’imiter dans cet amour grand et profond pour Jésus-Christ, de faire de notre vie, comme il fait de la sienne, un évangile vivant, de montrer en lui le visage miséricordieux et doux de Jésus de Nazareth. Que Marie nous obtienne cette grâce.
P. Luis Martinez IVE.