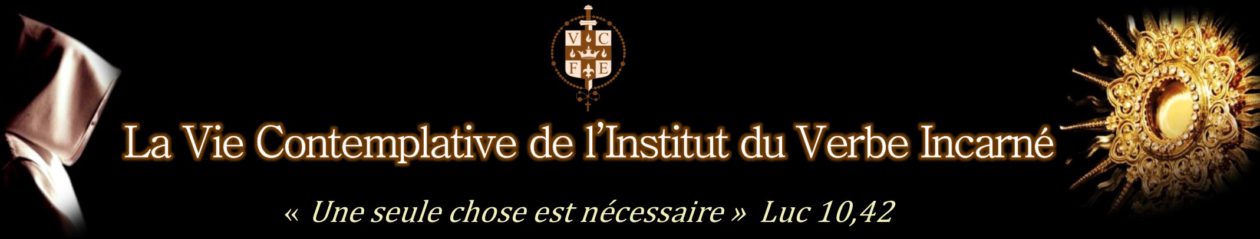Homélie pour le Dimanche XXX, année A (Mt 22, 34-40)
La Parole du Seigneur dans l’Evangile nous rappelle que toute la Loi divine se résume dans l’amour. L’Evangéliste Matthieu raconte que les Pharisiens se réunirent pour le mettre à l’épreuve (cf. 22, 34-35). L’un d’eux, un docteur de la loi, lui demanda: “Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi?” (22, 36).
Saint Thomas faisant le commentaire de ce passage enseigne : « cette question posée par le pharisien semblait calomnieuse et présomptueuse : calomnieuse, parce que tous les commandements de Dieu sont grands : Pr 6, 23 : Les commandements sont la lampe, et la loi, la lumière. Aussi, il posa une question de manière indéterminée, car tous sont grands, de sorte que si [le Seigneur] répondait au sujet d’un [commandement], il pourrait soulever une objection au sujet d’un autre. [Sa question] était aussi présomptueuse, car celui-là ne devrait pas s’enquérir du plus grand qui n’a pas accompli le plus petit.

« Dans sa réponse, Jésus cite le Shemà, la prière que le juif pieux récite plusieurs fois par jour, surtout le matin et le soir (cf. Dt 6, 4-9; 11, 13-21; Nb 15, 37-41): la proclamation de l’amour intégral et total dû à Dieu, en tant qu’unique Seigneur. L’accent est mis sur la totalité de ce dévouement à Dieu, en énumérant les trois facultés qui définissent l’homme dans ses structures psychologiques profondes: le cœur, l’âme et l’esprit. Le terme « esprit », diánoia , contient l’élément rationnel. Dieu est non seulement l’objet de l’amour, de l’engagement, de la volonté et du sentiment, mais également de l’intellect qui cependant ne doit donc pas être exclu de ce domaine. Plus encore, c’est notre propre pensée qui doit se configurer à la pensée de Dieu (Benoît XVI, homélie 26/10/2008) ».
Pour chacun de ces termes, le Seigneur met en avant le mot «tout», avec cela, Il nous montre que Dieu ne veut pas que même la plus petite particule de notre être reste sans l’aimer, Dieu veut un amour total.
Mais, juste après voir énoncé le grand commandement, Jésus ajoute quelque chose qui, en vérité, n’avait pas été demandée par le docteur de la loi: “Le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même” (v. 39). L’aspect surprenant de la réponse de Jésus tient en ce qu‘il établit une relation de ressemblance entre le premier et le second commandement. Et voici encore donc que, dans la conclusion du récit, les deux commandements sont associés dans le rôle de principe fondamental sur lequel repose toute la Révélation biblique : “A ces deux commandements se rattache toute la Loi, ainsi que les Prophètes” (22, 40). (Benoît XVI, homélie 26/10/2008)

Nous allons nous poser une question maintenant : Pourquoi le deuxième commandement, qui se réfère à l’homme, est-il similaire au premier commandement, qui se réfère à Dieu ? Parce que l’homme a été fait « à l’image et à la ressemblance de Dieu» (Gn 1,26-27). Parce que, selon les paroles de saint Thomas, lorsque l’homme est aimé, Dieu est aimé en lui, puisque l’homme est l’image de Dieu. [Le second commandement] est donc semblable au premier commandement, qui porte sur l’amour de Dieu.
Très éclairante est aussi pour nous l’explication donnée toujours par Saint Thomas d’Aquin par rapport aux paroles « comme toi-même » : ne s’entend pas au sens de : «autant que toi-même», car cela serait contre l’ordre de la charité, mais au sens de : «comme toi-même», c’est-à-dire comme la fin pour laquelle tu [t’aimes] ou à la manière dont tu [t’aimes].
Pour la fin, car tu ne dois pas t’aimer pour toi-même, mais pour Dieu ; de même en est-il pour le prochain, [comme dit] l’Apôtre, 1 Co 10, 31 : « Faites tout pour la gloire de Dieu ».
De même, dans le fait de t’aimer, tu t’aimes du fait que tu te veux du bien, et un bien qui te convienne et soit conforme à la loi de Dieu, et cela est le bien de la justice. Aussi dois-tu souhaiter une bonne justice pour le prochain (qu’il devienne juste, saint). Tu dois donc l’aimer soit parce qu’il est juste, soit parce qu’il est rendu juste.
De même, tu dois l’aimer à la manière dont tu t’aimes, car, lorsque je dis que j’aime celui-ci, je dis que je lui veux du bien. Ainsi, l’acte de l’amour porte sur deux choses : soit sur celui qui est bon, soit sur le bien lui-même que je lui veux. De sorte que j’aime celui-ci parce que je veux qu’il soit un bien pour moi (c’est-à-dire qu’il m’aide pour le bien). Quelqu’un aime les biens temporels parce qu’il sait qu’ils sont bons pour lui ; certains aiment quelque chose parce que cela est bon en soi.

Comme nous avons vu, la loi de Dieu est résumée dans ces deux grands commandements que Dieu a encore explicités et comme développé dans les dix commandements et nous les connaissons bien. Il est bien de rappeler certains aspects : d’abord, il faut toujours le dire, les commandements énoncés en 10 paroles, 10 phrases sont des lois qui contiennent d’autres lois, chaque commandement est un champ très vaste de la morale, que nous devons considérer au moment d’examiner notre conscience.
Il y a quelques dimanches, nous avons vu comme dans le cinquième commandement « Tu ne tueras pas », sont contenues beaucoup d’autres actions qui attaquent l’intégrité d’une personne, ses droits à la vie et la vie de l’innocent. C’est une grande responsabilité pour les chrétiens de nous former sur chacun des dix commandements, par rapport à tous les aspects de la vie morale qu’ils impliquent.
Une deuxième remarque par rapport aux commandements de la loi divine. Puisqu’ils expriment les devoirs fondamentaux de l’homme envers Dieu et envers son prochain, les dix commandements révèlent, en leur contenu primordial, des obligations graves. Ils sont foncièrement immuables et leur obligation vaut toujours et partout. Nul ne pourrait s’en dispenser. Les dix commandements sont gravés par Dieu dans le cœur de l’être humain. (Catéchisme de l’Eglise Catholique n. 2072)
Et le troisième aspect à souligner, c’est que le Décalogue (les dix paroles) forme un tout indissociable. Chaque ” parole ” renvoie à chacune des autres et à toutes ; elles se conditionnent réciproquement. Les deux Tables (de la loi) s’éclairent mutuellement ; elles forment une unité organique. Transgresser un commandement, c’est désobéir tous les autres : En effet, si quelqu’un observe intégralement la loi, sauf en un seul point sur lequel il trébuche, le voilà coupable par rapport à l’ensemble. « En effet, si Dieu a dit : Tu ne commettras pas d’adultère, il a dit aussi : Tu ne commettras pas de meurtre. Donc, si tu ne commets pas d’adultère mais si tu commets un meurtre, te voilà transgresseur de la loi »( Jc 2, 10-11). On ne peut honorer autrui sans bénir Dieu son Créateur. On ne saurait adorer Dieu sans aimer tous les hommes ses créatures. Le Décalogue unifie la vie théologale et la vie sociale de l’homme. (Catéchisme de l’Eglise Catholique n. 2069)

En lisant ces versets du Psaume 143 « Pour toi, je chanterai un chant nouveau, pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes » saint Augustin compare la harpe à la loi de Dieu. La harpe à dix cordes est pour lui la loi résumée dans ses dix commandements. Mais de ces dix cordes, de ces dix commandements, nous devons trouver la juste clef. Et ce n’est que si l’on fait vibrer ces dix cordes, ces dix commandements — comme le dit saint Augustin — grâce à la charité du cœur, que leur son est harmonieux. La charité est la plénitude de la loi. Celui qui vit les commandements comme dimension de l’unique charité, chante réellement le « chant nouveau ». La charité qui nous unit aux sentiments du Christ est le véritable « chant nouveau » de l’« homme nouveau », capable de créer également un « monde nouveau ». Ce Psaume nous invite à chanter « sur la harpe à dix cordes » avec un cœur nouveau, à chanter avec les sentiments du Christ, à vivre les dix commandements dans la dimension de l’amour, à contribuer ainsi à la paix et à l’harmonie du monde. (cf. Discours sur les Psaumes, 143, 16: Nuova Biblioteca Agostiniana, XXVIII, Rome 1977, pp. 677. Benoît XVI 25/01/06).
Demandons aujourd’hui la grâce d’aimer ce que Dieu nous commande à travers ses commandements, sachant toujours que ce que Dieu commande, Il le rend possible par sa grâce.
P. Luis Martinez IVE.