Le bon ordre dans l’assemblée
 La charité est l’unité de l’Eglise, de la communauté et aussi des familles. Nous utiliserons les chapitres 11 et 12 de la première lettre aux Corinthiens.
La charité est l’unité de l’Eglise, de la communauté et aussi des familles. Nous utiliserons les chapitres 11 et 12 de la première lettre aux Corinthiens.
-
La division : La division dans l’assemblée
On ne parle pas ici de la division en relation à la foi, parce que cela signifierait se séparer de l’Eglise. Lorsque Saint Paul parle de la division dans l’assemblée, il fait référence souvent sont à des affaires humaines.
« Dans quel moment il faut se mettre à genoux », « dans quel moment il faut sonner la cloche », les races (dans l’église apostolique les chrétiens venus du judaïsme méprisaient ceux venus du monde païen) les péchés, les blessures… (L’homme est pécheur, l’Eglise est composée d’hommes, donc l’Eglise est composée de pécheurs)
 Voyons comme saint Paul présente la division chez les corinthiens :
Voyons comme saint Paul présente la division chez les corinthiens :
(1 Co. 18- 21) J’entends dire que, parmi vous, il existe des divisions, et je crois que c’est assez vrai… Lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n’est plus le repas du Seigneur que vous prenez ; en effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l’un reste affamé, tandis que l’autre a trop bu.
-
L’unité sacramentelle
L’unité dans l’Eglise naît de la relation avec le Christ. La foi nous unit parce que nous croyons les mêmes Vérités, nous croyons en Dieu et à Dieu ; « nous croyons en Dieu et à tout ce qu’il nous a révélé, et à ce que l’Église nous propose de croire, parce que Dieu est la vérité même »[1]. L’espérance nous unit : « nous désirons et attendons de Dieu la vie éternelle comme notre bonheur, mettant notre confiance dans les promesses du Christ »[2]. La Charité nous unit : « nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes, par amour de Dieu. »[3]
Saint Paul remarque l’unité qui naît du sacrement. C’est-à-dire la communion au sacrement (communicatio in sacris)
 (1 Cor 10, 16-17) La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.
(1 Cor 10, 16-17) La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.
Pour cela, nous devons distinguer qu’au moment où on mange une pomme, la pomme devient partie de notre corps, mais par contre au moment où l’on participe de l’Eucharistie, du corps du Christ, nous devenons partie plus parfaitement du Corps mystique de Christ[4].
Le Corps Mystique c’est un sujet qui a été développé par le Pie XII en l’encyclique « Mystici corporis » et dans la constitution dogmatique « Lumen gentium ».
-
Diversité
C’est vrai nous sommes un dans le Christ, même si chacun est différent, pour cela Saint Paul ajoute « le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. » (1 cor 12, 12)
Nous sommes un en Christ et nous sommes différents … et maintenant, que nous devons faire ? Quelle est la façon de se comporter en tenant compte de cette différence ? :

Il ne faut pas se mépriser : « Parce que je suis prêtre je ne fais pas du bien comme tel… » « Etant fidèle, je ne fais aucun bien parce que je ne peux pas célébrer la messe ».
Saint Paul dit (1 Cor 12, 15- 16): 15 Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je fais pas partie du corps » 16 L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps.
Il ne faut pas mépriser nos prochains : « Les fidèles ne font rien, les prêtres ne font rien »…
Saint Paul dit : (1 Cor 12,21) L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ».
Les évêques, les prêtres, les moines, les religieux, les fidèles, les fidèles consacrés, les mariés, etc… Chacun a sa fonction, sa finalité.
 Il faut souffrir ensemble : Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance.
Il faut souffrir ensemble : Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance.
Par exemple, lorsqu’une partie de notre corps est malade, on dit Joseph est malade, on ne dit pas l’estomac de Joseph est malade, car c’est toute la personne qui souffre, c’est la personne qui avec tous ses membres essaie de retrouver la santé.
Il faut se réjouir ensemble : « si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. »
Encore un autre exemple, il s’agit toujours d’une personne celle qui joue le piano, une personne qui fait la cuisine. On peut dire « quelle main avez-vous ! » mais en vérité, c’est toute la personne qui a fait l’œuvre.
- La charité, accomplir pleinement la loi :
Tout cela fait naître la Charité et comme nous avons lu dans 2ème lecture « celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi »
Pour finir ce sujet, saint Paul prononce ce que l’on appelle l’hymne de la charité : « L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. » 1 cor 13
L’amour prend patience ; en relation au mal.
L’amour rend service : Donner à quelqu’un ce dont il a besoin.
L’amour ne jalouse pas : Il n’est pas attaché aux créatures, à l’honneur etc. La charité est attachée à Dieu et comprend que Dieu est pour tous.
Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; l’amour est humble… il ne cherche pas son intérêt.
Il n’entretient pas de rancune: Le pardon.
 Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. La contemplation, la prière.
Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. La contemplation, la prière.
- L’exemple du Christ.
L’exemple de comment vivre la charité nous l’avons en Jésus Christ.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jn 15, 13) « Dieu est amour. » (1. Jn 4, 8) mais cet amour a été révélé par Jésus Christ.
P. Andrés Nowakowski V. E.
Monastère « Bx. Charles de Foucauld »
[1] Compendium N 386
[2] Compendium N 387
[3] Compendium N 388
[4] Sommes théologique III Q 82
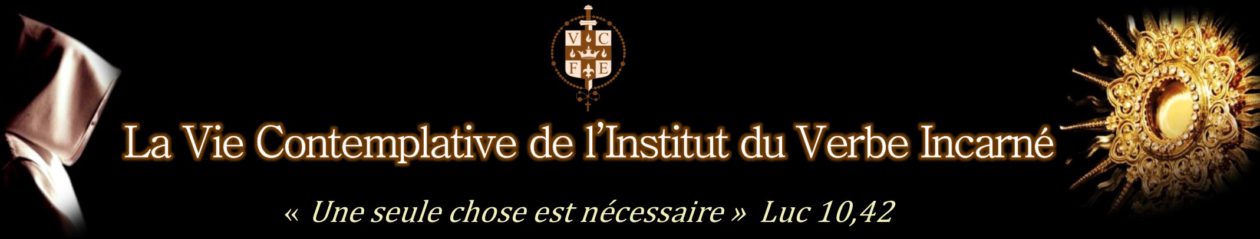

 QU’EST-CE QUE LE SCANDALE?
QU’EST-CE QUE LE SCANDALE? 2284 Le scandale est l’attitude ou le comportement qui portent autrui à faire le mal. Celui qui scandalise se fait le tentateur de son prochain. Il porte atteinte à la vertu et à la droiture ; il peut entraîner son frère dans la mort spirituelle. Le scandale constitue une faute grave si par action ou omission il entraîne délibérément autrui à une faute grave.
2284 Le scandale est l’attitude ou le comportement qui portent autrui à faire le mal. Celui qui scandalise se fait le tentateur de son prochain. Il porte atteinte à la vertu et à la droiture ; il peut entraîner son frère dans la mort spirituelle. Le scandale constitue une faute grave si par action ou omission il entraîne délibérément autrui à une faute grave.