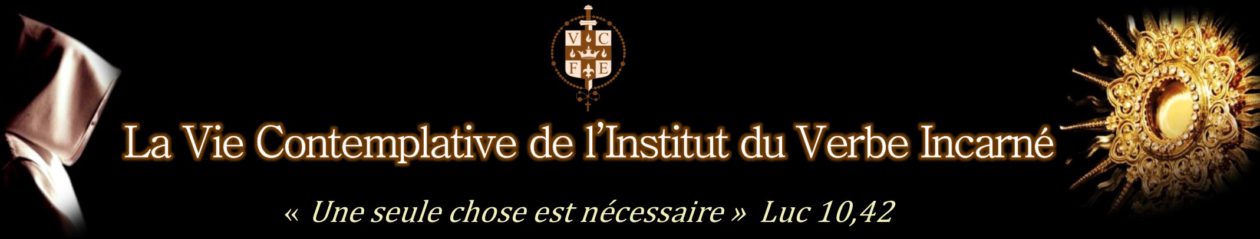Lire l’évangile du dimanche XXIII du temps ordinaire (Mc 7, 31-37)
L’évangile de ce dimanche nous décrit un miracle de notre Seigneur, un miracle qu’Il accomplit après un long voyage. En effet, le Seigneur est dehors de la Terre Sainte, saint Marc nous dit que Jésus était dans l’actuelle région du Liban pour faire un grand tour et revenir vers la mer de Galilée. On suppose que Notre Seigneur a profité de ce grand voyage pour former aussi ses apôtres. C’est à la fin de cette tournée qu’il fera la guérison qui est le sujet principal de notre évangile.
Ce miracle nous est raconté avec beaucoup de détails, comme vous savez le Seigneur accomplissait ses miracles de différentes façons ; pour certains juste un mot suffisait; pour d’autres, il les faisait de loin.
En effet, cette guérison est réalisée avec un ensemble de rites, de gestes qui ont évidement une signification. Les commentateurs disent que Notre Seigneur prononce ici une parabole, sans paroles, avec ses gestes et c’est évidement pour notre instruction. En effet, plusieurs des gestes accomplis lors de ce miracle ont été incorporés par l’Eglise parmi les rites du baptême, car les pères de l’Eglise ont vu en eux les effets de la foi, de ce que produit la foi dans notre âme.
Quelqu’un a écrit que de tous les handicaps, la surdité est la plus difficile à vivre. On peut percevoir la compassion de notre Seigneur dans le simple geste de l’éloigner de la foule, et de commencer par les gestes, car c’est précisément le langage que cette personne comprenait.
 L’organe de l’ouïe était nécessaire, soit pour la connaissance de la religion (car la profession de foi juive commence avec le mot « Ecoute, Israël ») soit pour l’ouverture à la société (pour communiquer avec les autres), le premier geste de Notre Seigneur a donc été d’introduire son doigt dans l’oreille de cette personne. Jésus touche la faiblesse humaine, se compénètre de la souffrance. C’est l’humanité malade par le péché, qu’Il a assumée pour la guérir, et pour cela un père de l’Eglise voit dans l’acte de toucher la langue avec sa salive l’image de l’Incarnation de Dieu, la divinité (le Verbe de Dieu) touche l’humanité pour la faire parler les vérités de Dieu.
L’organe de l’ouïe était nécessaire, soit pour la connaissance de la religion (car la profession de foi juive commence avec le mot « Ecoute, Israël ») soit pour l’ouverture à la société (pour communiquer avec les autres), le premier geste de Notre Seigneur a donc été d’introduire son doigt dans l’oreille de cette personne. Jésus touche la faiblesse humaine, se compénètre de la souffrance. C’est l’humanité malade par le péché, qu’Il a assumée pour la guérir, et pour cela un père de l’Eglise voit dans l’acte de toucher la langue avec sa salive l’image de l’Incarnation de Dieu, la divinité (le Verbe de Dieu) touche l’humanité pour la faire parler les vérités de Dieu.
Ensuite le Seigneur regarde le Ciel, « Il lève les yeux au ciel, dit saint Bède, pour nous apprendre que c’est de là que les muets doivent attendre la parole, les sourds l’ouïe, et tous les malades leur guérison. »
Ensuite, « en poussant un soupir » traduit notre édition liturgique, mais en vérité l’évangéliste dit que le Seigneur a gémi, comme un gémissement causé par la douleur et la souffrance, et pour cela on découvre par là, un signe de la Passion de Jésus, par laquelle Il nous a libérés de la souffrance et de la mort. Selon S. Jérôme : « Il nous apprenait ainsi à nous glorifier, non dans notre puissance ou dans notre vertu, mais dans la croix et l’humiliation ».
Mais c’est finalement la Parole de Jésus qui accomplit le miracle, « Effata ! », « Ouvre-toi ! ». Parole qui n’est pas dirigée aux organes, à la langue ou l’ouïe, mais à la personne tout entière, celle qui reçoit le miracle. On retrouvera ce même verbe, ouvrir, par exemple dans l’évangile des disciples d’Emaus : « au moment de voir rompre le pain leurs yeux s’ouvrirent, et ils reconnurent le Seigneur », ou bien après avec les autres disciples toujours après la Résurrection : « Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures ».
Bien que ce miracle soit souvent appliqué à la vertu de la foi et au sacrement du baptême, comme on l’a dit, nous pouvons aussi y remarquer comme dans tous les miracles des guérisons la mission de Notre Seigneur comme médecin non seulement de l’âme mais aussi du corps, son amour se dirige vers la personne tout entière. Le Christ nous montre aussi un amour spécial pour le corps humain, et l’on découvre en lui comme un respect. Nous le savons, au moment de notre mort nous devons nous séparer de notre corps, mais c’est une séparation temporaire parce qu’il est aussi appelé à la joie du Ciel, Dieu nous assure la résurrection des corps parce que sans lui, l’être humain serait incomplet.
Si nous devons imiter le Christ parce « qu’Il a bien fait toutes choses », nous devons donc conserver ce respect pour notre corps et pour son langage, qui sont essentiellement les gestes et les mouvements dans la liturgie (comme faisant partie de notre religion) et dehors de la liturgie, dans la vie quotidienne.
 Si nous parlons de la vertu de la religion, elle se compose d’actes internes (l’adoration à Dieu, la dévotion, supplication, action de grâces, parmi d’autres) et d’actes externes qui manifestent ce qu’on vient de dire.
Si nous parlons de la vertu de la religion, elle se compose d’actes internes (l’adoration à Dieu, la dévotion, supplication, action de grâces, parmi d’autres) et d’actes externes qui manifestent ce qu’on vient de dire.
Ces actes externes sont composés de gestes, attitudes, mouvements qui sont ordonnés et prescrits par l’Eglise même, généralement ils sont aussi commandés pour être exécutés pour garder une harmonie dans l’assemblée et pour nous aider à prier, en évitant les distractions de ce qui est essentiel.
Ces gestes, attitudes et cérémonies (processions, les positions dans la messe) sont d’abord l’expression de notre âme et ont comme finalité celle de mettre le corps au service de l’âme et tous les deux au service de Dieu. Ils doivent impulser l’esprit à la vénération des choses sacrées, l’élever aux réalités surnaturelles, nourrir notre piété, nous faire grandir dans la foi, l’espérance et la charité, en plus de la dévotion. Mais les gestes et attitudes sont aussi utiles pour les autres car le bon comportement et la modestie dans l’habillement servent d’instruction pour les gens simples et pour ceux qui découvrent la foi chrétienne, ils inspirent des pensées nobles et conservent la vertu de la religion.
Comme vous le savez généralement, dans la liturgie les gestes sont prescrits différemment pour les ministres et pour tous les autres participants dans l’ensemble. Le fait que l’Eglise veille à ce que nous gardions les mêmes cérémonies et les comportements prescrits pour les actes liturgiques aide évidement à montrer l’unité dans la foi, mais cela évite aussi les singularités (comme si chacun participait en faisant les gestes qui lui plaisent à la messe), ou bien d’autres éléments qui peuvent blesser le bon ordre et la beauté de la liturgie et l’humilité, faisant descendre l’esprit à des banalités  (si je me mets à danser à la messe il est très facile de cesser de penser en Dieu pour me mettre à penser à ma danse et à comment j’attire le regard des autres…).
(si je me mets à danser à la messe il est très facile de cesser de penser en Dieu pour me mettre à penser à ma danse et à comment j’attire le regard des autres…).
Mais notre gestuelle se poursuit aussi en dehors de l’Eglise, c’est notre deuxième point de ce dimanche. Notre corps et notre âme sont une image de Dieu, mais une image que nous pouvons souiller avec précisément l’abus que nous en faisons.
Le corps est malheureusement aujourd’hui, l’objet d’exploitation publicitaire, économique et hédoniste, qui contribue à diminuer la dignité de la personne pour la transformer en un instrument de marché.
Peu à peu, nous commençons à perdre le respect pour les autres et pour nous même, et cela pousse à une indifférence devant la dignité de la personne et le sens moral.
C’est à cela malheureusement que conduisent actuellement les différentes tendances médiatiques, à proposer une beauté seulement extérieure de la personne et à oublier son âme. Nous arrivons maintenant à la génération « selfie » et cela conduit à beaucoup de mal en nous. Cela se transforme en une sorte d’addiction à montrer l’intimité de notre corps et de notre vie, à nous exposer aux autres en biaisant ce qui est le plus important en nous, l’unité entre l’esprit et le corps.
La personne parle aussi à travers son corps, parce que son image externe et ses mouvements, ses gestes manifestent et expriment son identité, sa façon de penser, son vouloir, son caractère et sa psychologie. Quel message je montre à travers les réseaux sociaux de mon être et de ma personne ?
Nous ne devons pas oublier ici le secret de la vertu de la pureté et de la pudeur (cf. Catéchisme de l’Eglise Catholique nn. 2517-2527):
La pureté du cœur est le préalable à la vision de Dieu (les purs verront Dieu). Dès aujourd’hui (de ce monde), elle nous donne de voir selon Dieu, de recevoir autrui comme un ” prochain ” ; elle nous permet de percevoir le corps humain, le nôtre et celui du prochain, comme un temple de l’Esprit Saint, une manifestation de la beauté divine.
La pureté demande la pudeur. Celle-ci est une partie intégrante de la tempérance. La pudeur préserve l’intimité de la personne. Elle désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché. Elle est ordonnée à la chasteté dont elle atteste la délicatesse. Elle guide les regards et les gestes conformes à la dignité des personnes et de leur union.
La pudeur protège le mystère des personnes et de leur amour. Elle invite à la patience et à la modération dans la relation d’amour ; elle demande que soient remplies les conditions du don et de l’engagement définitif de l’homme et de la femme entre eux. La pudeur est modestie. Elle inspire le choix du vêtement. Elle maintient le silence ou le réserve là où transparaît le risque d’une curiosité malsaine. Elle se fait discrétion.
Il existe une pudeur des sentiments aussi bien que du corps. Elle proteste, par exemple, contre les explorations ” voyeuristes ” du corps humain dans certaines publicités, ou contre la sollicitation de certains médias à aller trop loin dans la révélation de confidences intimes. La pudeur inspire une manière de vivre qui permet de résister aux sollicitations de la mode et à la pression des idéologies dominantes.
Ecoutons encore une fois l’enseignement de saint Paul (1 Cor. 19-20) :
“Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps”.
Que la Reine du Ciel nous donne cette grâce.