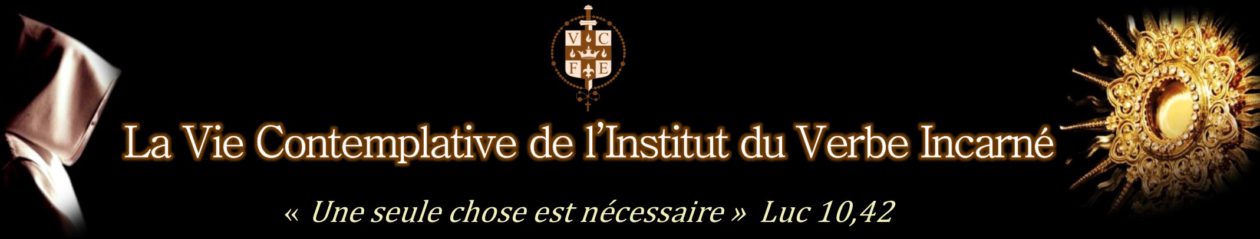Homélie pour le Dimanche II de l’Avent, année C (Lc 3, 1-6)
La liturgie de la Parole introduit ce dimanche l’image de saint Jean Baptiste. Dans cet évangile, saint Luc nous présente sa figure et toute son activité apostolique dans un cadre historique très bien défini. Sept personnages historiques sont indiqués avec leurs rôles respectifs ; cinq sont à la tête de gouvernements civils (l’empereur Tibère et les gouverneurs Pilate, Hérode, Philippe et Lysanias) ; deux sont des chefs religieux (Hanne et Caïphe). Avec cette référence, il est souligné, de la manière la plus forte et la plus claire possible, que l’action salvifique de Dieu n’a pas été vérifiée dans une indétermination fantastique ou mythique, mais plutôt dans un cadre temporel et spatial bien déterminé. Les indications valent surtout pour l’apparition de Jean-Baptiste. Mais, puisqu’il prépare la venue de Jésus et que son œuvre est suivie de l’œuvre de Jésus, ces indications s’appliquent également à l’apparition de Jésus.
Avec le fait de nommer ces personnages historiques, saint Luc veut pour nous démontrer que saint Jean-Baptiste et Jésus ne sont pas des figures mythiques incompréhensibles, des légendes imaginaires, mais qu’ils sont par contre ancrés dans un moment historique bien déterminé. « Dieu est entré dans notre histoire ». Il faut croire que la présence salvifique de Dieu s’est réalisée précisément à ce moment et en ce lieu, précisément en la personne de Jésus de Nazareth liée à l’histoire. En Lui, qui a ce nom concret, qui est né dans ce endroit déterminé et a vécu dans ce pays aussi concret, pendant ce temps précis et dans ces circonstances ; en Jésus et en aucun autre homme et en aucun autre lieu, Dieu, Créateur et Seigneur du monde, ne s’est rendu présent, opérant le salut pour tous les hommes, pour tous les temps et pour toute sa création ».
C’est pour la même raison que l’Eglise a mis dans sa profession de foi, le Symbole des Apôtres, le Crédo, « Jésus a souffert sous Ponce Pilate et a été crucifié ». Il utilise un des noms qui apparaissent dans l’Évangile d’aujourd’hui : Ponce Pilate. Il est très intéressant de noter qu’au sein de la profession de foi la plus solennelle et dans la manifestation la plus essentielle du dogme, comme le Credo, il y a un nom historique. Le Christ est ainsi à jamais ancré dans le temps historique dans lequel il a vécu et il n’est pas une invention pieuse de la première communauté des chrétiens comme certains ont voulu le faire croire au monde.
Quatre des sept noms qui apparaissent dans l’Évangile d’aujourd’hui sont liés à la mort du Christ ou celle de Jean-Baptiste. Ponce Pilate est celui qui condamnera Jésus à mort sur la croix (Lc 23,24). Hérode Antipas est celui qui fera arrêter et décapiter Jean-Baptiste (Lc 3,20 ; 9,9). Comme tétrarque de Galilée, il a juridiction sur Jésus (Lc 13,1) ; pour cette raison, Pilate lui fait conduire Jésus (Lc 23, 6-12). Anne et Caïphe, grands prêtres juifs, sont ceux qui se scandalisent du comportement de Jésus et demandent sa condamnation à mort (Jn 18, 13.24 ; Mt 26, 57-66). C’est pour montrer aussi que depuis le début de la mission de Jean, anticipant et préparant celle de Notre Seigneur, il existe déjà cette opposition face aux autorités civiles et religieuses, précisément comme chez les prophètes de l’Ancien Testament, mais saint Luc dévoile déjà la fin tragique de saint Jean et surtout le sacrifice suprême du Seigneur.
L’une des clés de l’Évangile d’aujourd’hui et, par conséquent, de ce temps de l’Avent est de comprendre le rôle de saint Jean-Baptiste comme un prophète. En effet, dans l’Évangile d’aujourd’hui, il est dit que « la Parole de Dieu vint à Jean dans le désert » (Lc 3,2). Cette expression est utilisée par les hagiographes de l’Ancien Testament pour désigner la vocation avec laquelle Dieu appelle quelqu’un à être son prophète. L’action de Jean est présentée comme l’appel d’un prophète de l’Ancien Testament (cf. Jr 1,1-2 : La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie au temps de Josias, fils d’Amone, roi de Juda, la treizième année de son règne) ». De plus, son œuvre de prophète est aussi indiquée : « Il parcourut la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés » (Lc 3,3). L’appel à la conversion est la tâche principale du prophète. Et, enfin, il est explicitement assimilé à un prophète lorsqu’il est dit que Jean est la voix dont parle Isaïe, c’est-à-dire qu’il est le prophète annoncé par Isaïe, ce prophète qui devait préparer la venue du Sauveur (Lc 3 , 4-6). Son ministère de prophète est annoncé dès sa naissance : « Il ira devant le Seigneur son Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie » (Lc 1,17). Le peuple le considère comme un prophète (Lc 20,6), mais c’est Jésus qui dit que Jean était plus qu’un prophète, car il a préparé les voies du Seigneur (Lc 7,26-27).
La prophétie dans le Nouveau Testament n’est pas comprise dans le sens de la vision antérieure des événements futurs, mais est comprise selon l’étymologie du mot. « Prophète » provient du verbe grec pro-femí. La préposition pro signifie essentiellement « au lieu de » et « devant » ; femí signifie ‘parler’. C’est pourquoi prophète, dans le NT, signifie « celui qui parle à la place d’un autre devant d’autres hommes ». Ainsi, le prophète serait le porte-parole ou le héraut de quelqu’un, et le terme grec désignerait un prédicateur, celui « qui prêche », plutôt que « celui qui prédit ».
La conversion qu’exige saint Jean-Baptiste s’exprime en quatre symboles, deux relatifs aux caractéristiques géographiques et deux relatifs au chemin. La première consiste à ce que les vallées (ravins) doivent être comblées. Alors, cette image, tout comme les autres garde un sens moral, il faut soulever les vallées de notre découragement et de notre lâcheté. Pour nous convertir à Dieu, nous devons abandonner le péché de lâcheté et de désespoir. Pour nous préparer à recevoir Jésus à Noël, nous devons nous revêtir de courage, d’audace et d’espérance.
La deuxième figure avec laquelle saint Jean-Baptiste, à la suite d’Isaïe, présente la demande de conversion est celle des montagnes qu’il faut abaisser. Pour dire « être abaissé », le texte grec original utilise le verbe « tapeinoo ». Ce verbe a un sens géographique et aussi un sens moral. Littéralement, cela signifie « abaisser une montagne » et, littéralement aussi, « s’humilier ». Pour se convertir sincèrement, il faut renoncer à tout orgueil et à toute arrogance, s’humilier et accepter volontiers les humiliations, abaisser les montagnes et les collines de notre orgueil ».
La troisième figure que saint Jean-Baptiste utilise est celle des chemins tortueux qu’il faut redresser. Dans le langage biblique, le chemin et la marche sont des métaphores utilisées pour exprimer la conduite morale du croyant. L’adjectif que le texte grec original utilise pour dire « tordu » est skoliós. Au sens moral, cela signifie « mauvais », « corrompu », « pervers ». Il fait référence à l’injustice au sens générique, c’est-à-dire à la fois à l’injustice envers Dieu (les trois premiers commandements du Décalogue) et à l’injustice envers les autres (les sept derniers commandements du Décalogue). Saint Grégoire le Grand explique : « Les voies tortueuses sont redressées, quand le cœur des méchants, tordu par l’injustice, est dirigé selon la règle de la justice ».
Le quatrième et dernier symbole que saint Jean-Baptiste utilise pour inviter à la conversion est celui des chemins rocailleux qu’il faut aplanir. Le mot du grec original qui est généralement traduit par « rocailleux » est l’adjectif trajýs. Il exprime un chemin avec des pierres ou des rochers, un chemin accidenté ; ou encore, un chemin inégal et c’est pourquoi il est souvent traduit par « âpre ». Dans un sens moral, les grecs Eschyle, Euripide, Platon et Aristote l’utilisent comme un homme « violent », « colérique » ou « impétueux ». C’est pourquoi, à juste titre, saint Grégoire le Grand dit : « Les chemins rocailleux deviennent plats, lorsque les âmes dures et colériques retournent à la douceur de la mansuétude, par l’infusion de la grâce divine ».
Le Fils de Dieu qui devait former et rassembler son Église, commence à opérer par sa grâce dans son serviteur : «La parole du Seigneur se fit entendre à Jean», etc. Ainsi ce n’est pas un homme, mais le Verbe de Dieu qui préside à la première formation de l’Église. Saint Luc proclame Jean prophète par cette formule abrégée : «La parole de Dieu se fit entendre à Jean».
En effet, celui qui est rempli de la parole de Dieu a-t-il besoin d’une autre recommandation, et l’Évangéliste n’a-t-il pas tout dit dans ces seules paroles ?
« La Parole est donc descendue afin que la terre, qui était auparavant un désert, produise ses fruits pour nous » (ibid.).
Que la sainte Vierge Marie et saint Jean Baptiste nous guident sur le bon chemin vers la célébration de la Nativité de Notre Seigneur.
P. Luis Martinez IVE.