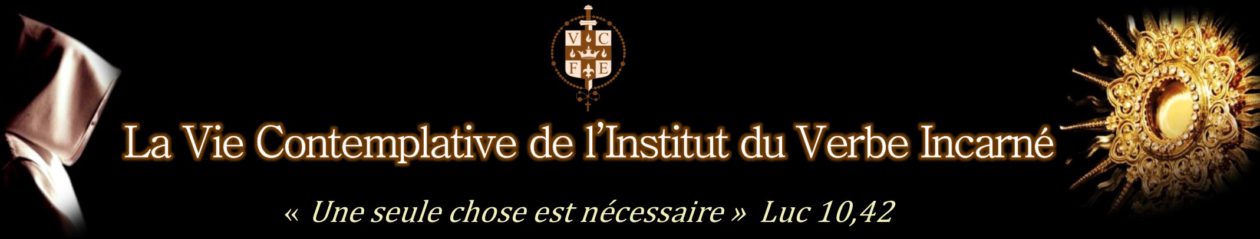Quarante jours s’étaient écoulés depuis la naissance du Sauveur à Bethléem ; le moment était venu où Jésus devait être présenté au Seigneur dans le Temple et où Marie, sa mère, devait offrir un sacrifice pour sa purification. En témoignage des droits qu’il avait sur le peuple choisi, soit comme principe de toute paternité, soit parce qu’il avait délivré Israël de la servitude de l’Égypte, Dieu avait voulu non seulement que les Lévites lui fussent spécialement consacrés, mais encore que tout premier-né d’entre les Hébreux lui fût offert et racheté au prix de cinq sicles. La présentation devait se faire par le père trente jours – ou même plus tard – après la naissance de l’enfant (Ex., XIII, 1, 2 ; XXXIV, 19 ; Num., XVIII, 15). Quant à la mère, elle devait, quarante jours après avoir mis au monde un enfant, se purifier de l’impureté légale ainsi contractée, en offrant en sacrifice un agneau, ou, si elle était pauvre, deux tourterelles (Lev., XII, 6, 8). Saint Joseph partit de Bethléem, reconnaissant envers tous ceux qui avaient pu lui témoigner quelque bonté, reconnaissant surtout envers Dieu pour toutes les joies que lui avait apportées la naissance du Sauveur, son adoration par les bergers, sa circoncision. Il traversa de nouveau le plateau de Rephaïm que le printemps commençait à embellir de sa première parure. Autrefois, Abraham avait suivi cette route, lorsqu’il allait immoler son fils Isaac sur le mont Moria. Des hauteurs qui couronnent la vallée de Hinnon, la Sainte Famille aperçut Jérusalem, avec ses murailles crénelées, la puissante ville de David, le Temple et, à l’arrière-plan, le Mont des Oliviers. Joseph, avec l’Enfant et sa mère, passa la nuit dans la ville ou dans l’un de ses faubourgs. Le lendemain, à l’heure du sacrifice du matin, la Sainte Famille se rendit au Temple, et, pour la première fois, le Sauveur contempla, de ses yeux mortels, le sanctuaire de Dieu parmi son peuple, les portiques, les ponts, l’enceinte, le parvis des Gentils par lequel on accédait, par des degrés, à la grande porte de Nicanor.
Là, se trouvait un vieillard, d’un aspect vénérable, qui semblait les attendre. S’avançant à leur rencontre, il s’inclina respectueusement et ouvrit les bras comme pour y recevoir le divin Enfant. C’était Siméon, que l’inspiration de l’Esprit-Saint avait conduit au Temple pour saluer le Sauveur. Marie lui confia l’Enfant. Fra Angelico nous représente le ravissement du saint vieillard : Siméon tient Jésus entre ses bras et le contemple comme on contemple un visage chéri, connu et aimé depuis longtemps. A la vue de la beauté éternellement jeune de ce Dieu qu’il adore, Siméon sent son cœur se rajeunir, ses lèvres s’entrouvrent et il chante ce cantique d’action de grâces que l’Église redit chaque soir pour remercier le Seigneur. Dans les yeux de Jésus, il découvre, dirait-on, une grandiose vision : il lit tous les mystères de l’Homme-Dieu jusqu’au dénouement sanglant du Calvaire En son cantique, tout d’abord il remercie Dieu de ce que son heure est venue et de ce qu’il a pu voir le Salut du monde. Il meurt avec joie, car la vie n’a rien de plus beau à lui offrir. Cet Enfant, – cette Lumière véritable – que ses mains tremblantes élèvent maintenant dans le Temple, il la voit se répandre non seulement sur Israël, mais jusqu’aux îles les plus lointaines et sur les nations païennes. Mais avec tristesse et douleur il reconnaît que cette Lumière sera un jugement, que cet Enfant doit être une pierre d’achoppement et un signe de contradiction pour un grand nombre, même en Israël. Il rend l’Enfant à sa mère à laquelle il prédit de mystérieuses souffrances, sous l’image d’un glaive qui transpercera le cœur et l’âme de Marie.
Sur ces entrefaites, Anne survient. C’était « une veuve, fort avancée en âge » ; « et elle demeurait sans cesse dans le temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeunes et dans les prières » (Luc. II, 37). A son tour, elle reconnut en Jésus le Sauveur, le Messie ; sur ses joues pâles et amaigries, dans son regard éteint par les ans, on vit le reflet d’une joie toute céleste. Et « elle se mit à louer le Seigneur, et à parler de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d’Israël » (Luc. II, 38).
Marie et Joseph admiraient dans leur cœur comment, par des témoignages si divers, au ciel et sur la terre, Dieu révélait toujours davantage la gloire du divin Enfant en même temps que les événements caractéristiques de sa vie mortelle. Cette dernière révélation prenait une importance singulière, parce qu’elle avait lieu dans le Temple même, parce qu’elle était faite par des personnages d’une sainteté notoire en présence d’un grand nombre de témoins, parce qu’elle prédisait des destinées exceptionnelles. Mais, en découvrant ainsi l’avenir de l’Enfant, Siméon avait fait au cœur de Marie et à celui de Joseph une blessure qui ne devait plus se fermer. « Qu’en sera-t-il donc de cet Enfant bien-aimé ? » Joseph dut souvent se poser cette question en serrant Jésus sur son cœur, en le voyant grandir sans cesse en grâce et en sagesse. Et ses larmes coulaient, larmes d’amour et de douleur tout à la fois. Peut-être, avant de quitter cette terre, aura-t-il vu le voile s’entrouvrir ! peut-être son regard aura-t-il lu clairement dans l’avenir !
Franchissant la balustrade de pierre qui séparait le Parvis des Gentils du Temple proprement dit, Marie et Joseph gravirent les degrés conduisant à la Porte de Nicanor. Près de là, à droite, se faisaient les rites de la purification pour les femmes après la naissance d’un enfant : elles devaient se présenter au prêtre qui récitait quelque prière et une formule de bénédiction ; et, dès lors, elles avaient de nouveau accès au Parvis des femmes. C’est là, aussi, qu’on voyait ces troncs à l’orifice en forme de trompette, destinés à recevoir les offrandes pour les divers sacrifices et, selon la somme ainsi recueillie, on immolait, après le sacrifice public du matin, un nombre plus ou moins grand d’agneaux et de tourterelles. Marie se soumit à la cérémonie de la purification, comme son Fils s’était soumis à la loi rituelle de la circoncision : dans l’intention du législateur et d’après l’esprit de la loi elle-même, elle n’y était nullement obligée.
A partir du XIIIe siècle, l’art religieux ne manque point de nous montrer saint Joseph présent à la cérémonie de la purification : il porte, dans une corbeille ou dans une petite cage, les tourterelles du sacrifice.
Après cette cérémonie – ou même pendant qu’elle avait lieu – le père offrait son enfant premier-né au Seigneur et le rachetait à prix d’argent : offrande et rachat se faisaient à gauche de la Porte de Nicanor, à la Porte du milieu sur le côté sud du Parvis des prêtres. Selon le rite prescrit, saint Joseph, en sa qualité de père, remit l’Enfant à un prêtre qui, l’élevant entre ses bras et se tournant vers le Saint des Saints, l’offrit au Seigneur et, après le paiement des cinq sicles, le rendit au père en prononçant une formule de bénédiction.
Le Sauveur daigna se soumettre à la cérémonie de la présentation au Temple. Certes, il n’avait pas besoin d’être consacré au Seigneur ou sanctifié : l’union de son humanité sainte avec la seconde Personne de la Divinité le sanctifiait et l’unissait à Dieu mieux que ne pouvait le faire un sacrement ou un rite quelconque. Jamais, sous l’Ancien Testament, sacrifice plus excellent n’avait été offert dans le Temple ; sa grandeur, sa beauté, sa gloire illuminaient le Temple, la terre entière, l’universalité des siècles et faisaient, par leur contraste, ressortir l’indigence et l’insuffisance de l’ancien culte. En ce jour, parce que le Messie venait d’y entrer, le Temple brillait de la splendeur dans laquelle le prophète (Agg., II, 10) l’avait contemplé. Ce sacrifice réunissait en lui seul tous les sacrifices de la Loi ancienne ; par-là, le sacerdoce ancien atteignait l’apogée de sa gloire ; Dieu lui-même accueillit l’offrande plus miséricordieusement encore qu’au jour solennel où Salomon célébra la dédicace du temple. C’était là, sur le mont Moria, que le patriarche Abraham avait offert au Seigneur son fils premier-né ; et, maintenant, voici qu’un autre Abraham, incomparablement plus juste que le premier, incomparablement plus cher à Dieu, renouvelle le sacrifice. C’est saint Joseph ; et Dieu fait de l’Époux de Marie le patriarche de la Loi nouvelle. Si Marie, Siméon et Anne ont accompagné Joseph en cette cérémonie, glorifiant le Seigneur et répétant les paroles du Psalmiste : « Dieu est bon, sa miséricorde est éternelle : au milieu de votre temple nous avons éprouvé votre miséricorde » (Ps. CXVII, 1 ; XLVII, 10), n’était-ce pas en quelque sorte la première procession de la Chandeleur, cette « Fête des lumières », qui a toujours été et qui sera toujours en honneur dans l’Église ?
Saint Joseph, dans la Vie de Jésus-Christ et dans la Vie de l’Eglise
R. P. M. Meschler S. I.