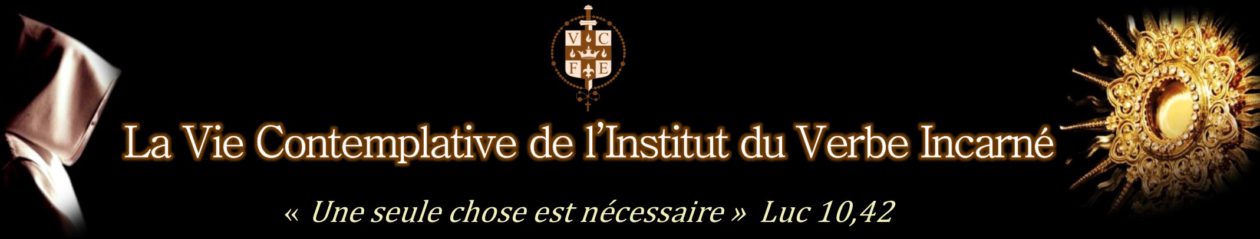Homélie pour le IVème. Dimanche du Temps Ordinaire, année B (Mc 1, 21-28).
Dans l’évangile de ce dimanche, saint Marc nous décrit les débuts du ministère de Notre Seigneur, en Galilée, plus précisément à Capharnaüm ( Saint Jérôme dit que ce nom veut dire ville de Consolation, là où le Seigneur a donné la consolation et le repos, parce que c’était le jour de sabbat qu’Il a guéri le possédé de la synagogue).
Le Seigneur enseigne et fait des miracles, Il montre qu’il a le pouvoir sur les démons, ce que fait dire aux gens « Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs », évidement cela accomplit la prophétie d’Isaïe, qu’était la première lecture d’aujourd’hui : Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai.
Mais, il est intéressant pour nous d’écouter la suite de cette prophétie : Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte.
Ce n’est pas cela pourtant, que le passage évangélique de ce dimanche nous montre, au contraire, il dit clairement que tous était étonnés par l’enseignement du Seigneur.
Alors, partant de la phrase d’Isaïe mentionnée plus haut, nous pouvons nous demander : Comment nous aimons l’enseignement de Jésus, comment nous aimons la Vérité qu’Il transmet dans les évangiles et toute la Parole de Dieu. Parce que ce n’est pas le seul fait d’écouter ou non ce dont prophète est en train de nous avertir, mais l’amour qui nous fait écouter et faire nôtre la Vérité.
Dans la vie de Jésus, beaucoup l’ont écouté, beaucoup aimaient ce qu’Il proclamait, mais d’autres, ont fermé les oreilles au message du Seigneur comme les pharisiens ou les grands prêtres. Evidement cela n’était pas fini dans la vie terrestre de Jésus, dans l’histoire beaucoup se ferment à l’Evangile, refusent de l’accepter.
Saint Paul dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens parle de condamnés qui ont été séduits par le démon, il parle d’eux au présent disant : « ceux qui se perdent parce qu’ils n’ont pas accueilli l’amour de la vérité (ou bien accepté l’amour de la vérité), ce qui les aurait sauvés.
C’est pourquoi Dieu leur envoie une force d’égarement qui les fait croire au mensonge ; ainsi seront jugés tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal.
Alors ce n’est pas l’ignorance, l’erreur, sinon un rejet envers la vérité elle-même. En d’autres mots : « Personne ne peut se sauver s’il refuse la Vérité » (évidement, d’abord il faut la connaître, mais une fois connue, la refuser signifie la condamnation). Dans le cœur de tout homme et femme, Dieu a mis ce désir pour chercher la vérité de toutes choses, et qui conduit aussi et le prépare pour découvrir la Vérité de Dieu, Dieu offre à tous l’amour pour la Vérité, comme dit le Concile Vatican II il y a ceux qui cherchent encore dans les ombres et sous des images un Dieu qu’ils ignorent, de ceux-là mêmes Dieu n’est pas loin, puisque c’est lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses (cf. Ac 17, 25-28), et puisqu’il veut, comme Sauveur, amener tous les hommes au salut. (Lumen Gentium 16)
Alors la Vérité seulement peut sauver lorsqu’elle n’est pas seulement connue, mais aimée. Il ne s’agit pas de connaître les évangiles, il s’agit d’aimer ce que on lit en eux. C’est-à-dire notre volonté « nous pousse » à aimer cette vérité que notre intelligence nous présente ; et c’est seulement là qu’une personne peut vraiment se laisser transformer par la vérité, ce que nous appelons une véritable conversion. Et c’est pour cela que la mission principale des éducateurs ( parents, formateurs) est de faire aimable ce qu’ils enseignent, que les vérités transmises aux autres portent une valeur afin d’être aimées dès la première fois qu’elles arrivent à l’âme de l’autre personne. Malheureusement il y a très peu d’hommes et femmes qui puissent faire aimer un enseignement, en même temps qu’il le transmet.
Cherchons Dieu de toute notre âme. Pascal – ce grand penseur français – a écrit à juste titre :Il y a trois sortes de personnes : les uns qui servent Dieu l’ayant trouvé, les autres qui s’emploient à le chercher ne l’ayant pas trouvé, les autres qui vivent sans le chercher ni l’avoir trouvé. Les premiers sont raisonnables et heureux, les derniers sont fous et malheureux. Ceux du milieu sont malheureux et raisonnables.
Que la Sainte Vierge nous donne la grâce de chercher son Fils de toute notre âme.
P. Luis Martinez. IVE.