Lire l’évangile du dimanche XXXII (Mt 25, 1-13)
Nous sommes presque à la fin de l’année liturgique, et les lectures commencent à préparer notre esprit au temps de l’Avent. Nous avons écouté la deuxième lecture, saint Paul nous avertit et nous éclaire sur la Venue de Notre Seigneur et sur la résurrection de tous les morts, la Résurrection de la chair, comme nous le disons dans le Credo.
Le texte de l’évangile, dans cette parabole appelée par la tradition la parabole des dix vierges, nous fait aussi réfléchir sur les derniers temps, là où se fera notre rencontre « visible » avec le Christ, en qui l’Apocalypse voit l’ Epoux pour qui l’Eglise Triomphante -la Jérusalem Céleste- s’est préparée comme une épouse pour le recevoir.
Cette parabole, si nous pouvons la situer chronologiquement dans la vie du Christ, est une des dernières qu’Il a prêchées. Elle est une de ses dernières recommandations pour tous les disciples qui l’écoutaient et cette histoire a comme finalité de faire comprendre la véritable sagesse de tout chrétien, la véritable sagesse qui consiste uniquement à sauver l’âme, à atteindre le Ciel pour pouvoir voir et se réjouir de Dieu et cela pour l’éternité.
Le véritable sage, le véritable savant dans ce monde est celui qui cherche à plaire à Dieu en toute chose, à accomplir Sa Volonté et procurer le salut de son âme et le salut des autres. Il est toujours bien de nous rappeler ce petit poème en espagnol qui dit « qu’à la fin de la journée (la vie), celui qui se sauve sait, et celui qui ne se sauve pas ne sait rien ». La Sagesse, on l’a proclamé dans la première lecture, se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.
 Alors, que l’évangile parle de cette véritable sagesse n’est pas difficile à comprendre, parce que dans notre histoire apparaissent ces dix jeunes filles, les prévoyantes et les insouciantes, on peut dire aussi les sages et les insensées. Mais si nous examinons plus en détail chaque partie et chaque description de tous les symboles qu’elle contient nous pouvons découvrir certains éléments très utiles à notre méditation et qui peuvent éclairer notre vie comme disciples de Jésus.
Alors, que l’évangile parle de cette véritable sagesse n’est pas difficile à comprendre, parce que dans notre histoire apparaissent ces dix jeunes filles, les prévoyantes et les insouciantes, on peut dire aussi les sages et les insensées. Mais si nous examinons plus en détail chaque partie et chaque description de tous les symboles qu’elle contient nous pouvons découvrir certains éléments très utiles à notre méditation et qui peuvent éclairer notre vie comme disciples de Jésus.
Tout d’abord cette parabole est une histoire qui nous renvoie au futur, le royaume des Cieux « sera » comparable, ici, l’expression « Royaume de Cieux » désigne plutôt la venue de ce Royaume, la Venue de Notre Seigneur.
L’image que le Seigneur utilise est une fête de Noces. Parmi les cérémonies d’un mariage la principale était celle où le nouvel époux devait se rendre à la maison paternelle de son épouse et partir dans une sorte de procession jusqu’à la nouvelle maison. Avec la future mariée il y a avait aussi un groupe de jeunes filles prêtes pour accompagner les deux mariés avec des lumières et des chants. Mais voici que dans cette parabole, comme dans toutes les paraboles du Seigneur, il y a quelques éléments qui peuvent nous étonner, comme ils déconcertaient d’ailleurs les disciples de Jésus qui écoutaient de lui cette parabole.
La première difficulté c’est que pour une procession pendant la nuit, des lampes ne suffisaient pas, il aurait fallu apporter des torches. La deuxième, le fiancé devait arriver au début de la soirée et non pas au milieu de la nuit (« au plus profond de la nuit » dit le texte), à quelle heure aurait donc commencé le dîner s’il venait tellement tard ? La troisième, il est presque impossible pour les jeunes de s’endormir au milieu d’une fête de noces, car il faut savoir qu’une fête de ce genre (et dans les cultures sémitiques, surtout) signifie beaucoup de bruit (des chants et de la musique). La quatrième difficulté consiste en la réponse donnée par les bonnes, elle ne semble pas charitable, elles se montrent un peu égoïstes. La cinquième c’est de penser si, au milieu de la nuit on trouverait quelqu’un pour vendre l’huile nécessaire aux lampes, comme elles ont voulu le faire, d’où leur arrivée en retard. La sixième, l’Epoux est vraiment dur avec celles qui arrivent, car pour un petit retard il n’ouvrira jamais plus la porte. Et la dernière des difficultés, où se trouve la fiancée de cette histoire ?
Toutes ces difficultés s’éclaircissent lorsque nous comprenons que le Seigneur fait référence à la fin du temps (« le royaume des cieux sera comparable »). D’abord et c’est le premier enseignement, il ne faut pas oublier qu’Il doit arriver et qu’Il peut tarder mais qu’une fois le Seigneur arrivé il n’y aura plus le temps pour faire ce qu’on devait prévoir et faire avant son arrivée.
Alors, on peut penser qu’Il viendra après, et nous endormir comme l’ont fait toutes ces jeunes filles. Elles sont comme une image de ceux qui croient en Jésus, mais il en y a qui, bien qu’ils s’assoupissent un peu, gardent pourtant le nécessaire pour cette rencontre.
 Et le Seigneur dit bien « des lampes » et non des torches, car l’huile symbolisait toujours les bonnes œuvres des personnes qui nous font grandir dans la charité, il est impossible que je puisse partager ma charité ou que j’en prête un peu ou beaucoup à celui qui n’en a pas et voilà la raison pour laquelle les filles sages ne pouvaient pas donner l’huile de leurs lampes à celles qui étaient insensées et non prévoyantes. Lorsqu’on dit des bonnes œuvres, on veut dire vivre toute la loi chrétienne, qui inclut aussi de faire du bien aux autres.
Et le Seigneur dit bien « des lampes » et non des torches, car l’huile symbolisait toujours les bonnes œuvres des personnes qui nous font grandir dans la charité, il est impossible que je puisse partager ma charité ou que j’en prête un peu ou beaucoup à celui qui n’en a pas et voilà la raison pour laquelle les filles sages ne pouvaient pas donner l’huile de leurs lampes à celles qui étaient insensées et non prévoyantes. Lorsqu’on dit des bonnes œuvres, on veut dire vivre toute la loi chrétienne, qui inclut aussi de faire du bien aux autres.
Saint Jean Chrysostome dit que dans l’autre monde, celui à qui manqueraient ses propres œuvres (la charité) personne ne pourra le secourir, car cela leur sera impossible. D’autre part, Saint Thomas d’Aquin remarque que les insensées demandent de l’huile car leurs lampes étaient « en train de s’éteindre » et que cela signifie que ces cinq filles sont l’image de ceux qui ont la foi (figurée par la flamme) mais qu’elle est condamnée à mourir à défaut d’être alimentée avec l’huile de la charité ; c’est une foi informe, parce que la vertu de la charité donne la forme aux autres vertus.
 Encore une autre précision sur les mots utilisés par l’évangéliste. On dit que les cinq jeunes filles étaient insouciantes, mais l’adjectif féminin en grec c’est « moraì » (féminin pluriel de « moros ») il s’agit de la personne qui a perdu totalement la raison, celui qui est fou, mais aussi le sot, l’idiot et le stupide. Tandis que pour les autres cinq prévoyantes, le mot en grec peut être traduit par prudentes, sages et intelligentes. On pourrait dire que dans cette parabole il s’agit donc des jeunes filles, les prudentes et les insensées.
Encore une autre précision sur les mots utilisés par l’évangéliste. On dit que les cinq jeunes filles étaient insouciantes, mais l’adjectif féminin en grec c’est « moraì » (féminin pluriel de « moros ») il s’agit de la personne qui a perdu totalement la raison, celui qui est fou, mais aussi le sot, l’idiot et le stupide. Tandis que pour les autres cinq prévoyantes, le mot en grec peut être traduit par prudentes, sages et intelligentes. On pourrait dire que dans cette parabole il s’agit donc des jeunes filles, les prudentes et les insensées.
Rappelons ici que la prudence est une vertu. C’est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toute circonstance notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir. ” L’homme avisé surveille ses pas ” (Pr 14, 15). La prudence est la ” droite règle de l’action “, écrit saint Thomas (s. th. 2-2, 47, 2) après Aristote. Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la dissimulation. Elle conduit les autres vertus en leur indiquant règle et mesure. C’est la prudence qui guide immédiatement le jugement de conscience. L’homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement. Saint Augustin disait que la prudence c’est « l’amour qui sait discerner de ce qui est utile pour aller vers Dieu de ce qui peut m’éloigner de Lui ».
Et pour conclure, nous savons qu’il y a un moment fixé par Dieu où l’on ne peut plus négocier la vie éternelle, c’est quand la porte se fermera, parce que l’Epoux est arrivé, qui est le moment de la mort et c’est irréversible. Et même si nous avons connu le Christ et que l’on dira : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ sans l’huile de la charité dans nos lampes, nous ne serons pas admis dans ce banquet éternel, cette fête de noces qui est contemplation pour l’éternité du visage du Dieu. Dans cette histoire la fiancée, la future épouse est comme absente, parce que finalement chaque personne doit atteindre Jésus comme le véritable époux de son âme, pour qui nous devons travailler, à qui nous devons penser, en qui nous devons espérer avec nos lampes remplies de charité, jusqu’au moment où notre ange gardien nous dira : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre’. Que la Vierge Marie nous donne la grâce d’être prêts pour le recevoir.
Et même si nous avons connu le Christ et que l’on dira : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ sans l’huile de la charité dans nos lampes, nous ne serons pas admis dans ce banquet éternel, cette fête de noces qui est contemplation pour l’éternité du visage du Dieu. Dans cette histoire la fiancée, la future épouse est comme absente, parce que finalement chaque personne doit atteindre Jésus comme le véritable époux de son âme, pour qui nous devons travailler, à qui nous devons penser, en qui nous devons espérer avec nos lampes remplies de charité, jusqu’au moment où notre ange gardien nous dira : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre’. Que la Vierge Marie nous donne la grâce d’être prêts pour le recevoir.
P. Luis Martinez V. E.
Institut du Verbe Incarné
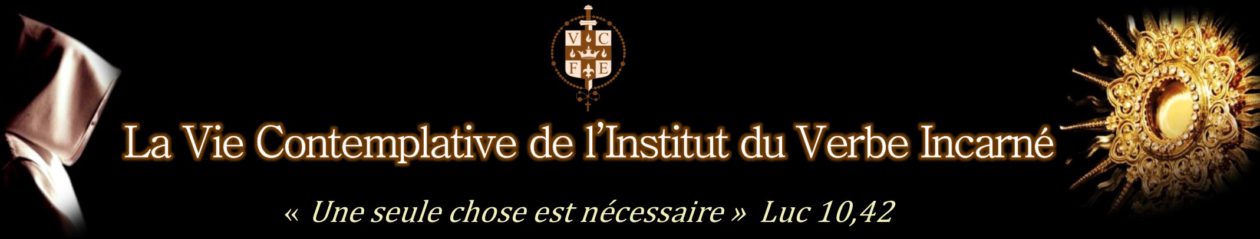








 Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. La contemplation, la prière.
Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. La contemplation, la prière.