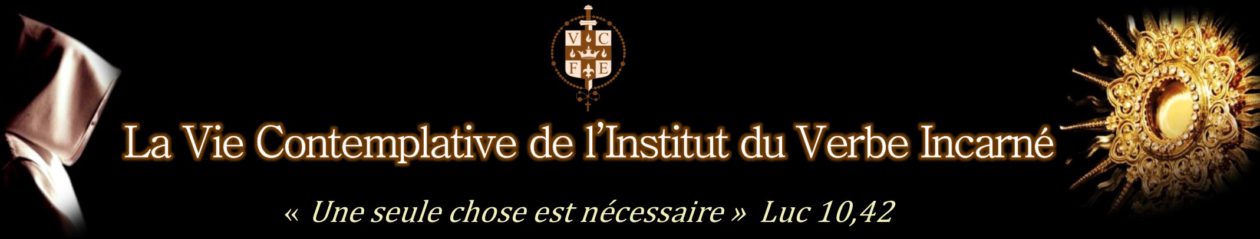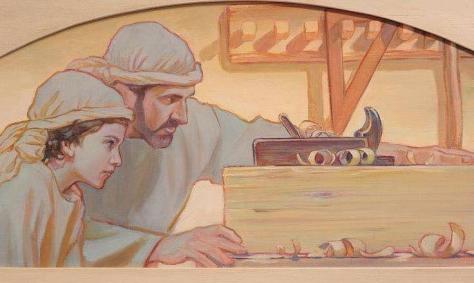La vie de l’homme n’est ni exclusivement intérieure, ni exclusivement extérieure. Composé d’un corps et d’une âme, l’homme est appelé à exercer son activité dans une double sphère. En outre, il ne vit point isolé : il vit en société, il entre forcément en rapport avec ses semblables. Sa vie est donc mixte, c’est-à-dire tout à la fois extérieure et intérieure.
Saint Joseph a connu cette loi de notre nature : aussi, en même temps que la vie intérieure, trouvons-nous en lui la vie extérieure. Il ne fut point un ermite ; il ne fut pas un de ces Esséniens, si nombreux alors en Judée. Il vécut dans la société de ses semblables, et, tout d’abord, de la Sainte Famille dont il était le chef, le soutien et le protecteur ; puis il fut en relations, même fréquentes, avec ses concitoyens, et il exerça une profession qui, nécessairement, le mettait en contact avec les personnes du dehors. Il dut voyager à plusieurs reprises : chaque année, tout au moins, il se rendait à Jérusalem pour les grandes solennités. Quand il dut fuir, sur l’ordre de Dieu, il alla jusqu’en Egypte et y séjourna un certain temps. Si l’art chrétien le représente un bâton à la main, c’est, entre autres significations, pour rappeler ses voyages. Enfin, saint Joseph exerça une profession, une profession toute commune et matérielle, un métier, parce qu’il devait, par son travail, assurer à la Sainte Famille le pain quotidien. Voilà pourquoi, dans les peintures ou mosaïques des premiers siècles, nous voyons une scie ou une hache même auprès de la crèche : ce sont les outils du charpentier.
Mais cette vie extérieure de notre saint fut une vie admirablement ordonnée et parfaite. En voici les raisons :
Premièrement, les motifs dont Joseph s’inspirait ; c’est-à-dire ses devoirs d’état, la volonté ou la permission de Dieu, l’amour de Jésus et de Marie qui formaient sa famille, bien souvent aussi la charité pour le prochain et le noble désir de lui venir en aide. S’il se mêlait à ses concitoyens, ce ne fut jamais par un sentiment d’ennui ou de lassitude dans son labeur, par désœuvrement, par caprice, uniquement pour son plaisir, en quête de nouveautés ou de consolations. Il est bien certain que ses voyages à Nazareth et en Egypte ne furent point des voyages de plaisir. D’après les principes de la perfection et les maximes des saints, la vie extérieure doit découler en quelque sorte de la plénitude de l’esprit intérieur, elle doit être une effusion de notre amour pour Dieu et pour le prochain.
Deuxièmement la vie extérieure de saint Joseph fut une vie admirablement ordonnée et parfaite, par la manière dont il s’y comportait. Il s’y livrait sans que le soin de sa vie intérieure, la vigilance sur son âme et son union à Dieu eussent rien à en souffrir. Sa vie extérieure était comme l’épanouissement de son âme : la pensée de Dieu, l’amour de Dieu inspiraient, accompagnaient et ennoblissaient chacun de ses actes, et les transformaient en autant d’actes de vertu. La vie intérieure, loin d’être compromise par la vie extérieure, s’enrichissait continuellement de toutes les difficultés et contrariétés, de tous les sacrifices qui se présentaient : la charité divine allait aussi grandissant sans cesse, et notre saint goûtait en outre la consolation d’avoir été utile à ses semblables.
Saint Joseph nous donne ainsi une grande leçon. Tous nous devons vivre d’une vie extérieure : il faut ordonner cette vie ; tous nous devons travailler : il faut travailler de la bonne manière. Et ici, nous avons deux écueils à éviter : le défaut et l’excès.
Le défaut
Souvent l’on travaille trop peu : c’est l’oisiveté, la perte du temps, le manque de sérieux, la négligence à consacrer notre vie, nos forces et nos talents à la gloire de Dieu et au bien du prochain. Souvent, aussi, le mal ne consiste point à ne rien faire, à ne se donner aucune occupation, mais à se dépenser en une foule d’affaires inutiles, à s’occuper de choses qui ne rentrent ni dans notre vocation ni dans nos devoirs d’état, qui n’ont aucune utilité réelle ni pour nous-mêmes ni pour nos semblables. Agir et travailler ainsi, ce n’est point agir ni travailler : c’est se remuer, s’agiter, suivre son caprice ; c’est ainsi que travaillent certains oiseaux qui passent leur temps à lisser leur plumage, à sautiller d’un barreau à l’autre de leur cage, à chanter une roulade, à manger et à boire. Est-ce travailler que d’aller de visite en visite, d’un cercle à un autre cercle, d’un passe-temps à un autre passe-temps, sans s’accorder un instant de repos ? Le travail, au véritable sens du mot, c’est le travail demandé par nos devoirs d’état, le travail utile, le travail en rapport avec notre vocation. Tout le reste n’est qu’un moyen de fuir l’ennui, d’échapper à une solitude mortelle. Examinons sérieusement devant Dieu et devant notre conscience de quelle manière nous employons notre vie, nos forces et nos talents. Un jour, Dieu nous demandera compte non seulement du mauvais emploi, mais encore de la perte du temps. Un homme de cœur devrait avoir honte de manger sans avoir mérité sa nourriture, et de rester tranquillement les bras croisés, alors qu’un si grand nombre de ses semblables doivent se soumettre à un dur labeur, alors que le Sauveur et sa sainte Mère et saint Joseph ont dû péniblement gagner le pain quotidien. Le pain qu’on n’a point gagné est un pain volé, du moins devant Dieu, car il est dit : « Celui qui ne veut point travailler ne doit pas manger » (II Thess. III, 10). Et voyons en outre si, nos devoirs d’état accomplis, il ne nous reste rien à faire pour venir en aide au prochain, pour remplir notre mission sociale, pour répondre aux nécessités de notre époque en prenant une part active aux œuvres de charité. La pratique du grand précepte de l’amour de Dieu et du prochain n’est-elle pas de tous les instants ? Que chacun se mette à travailler pour le bien de tous, et les questions sociales seront bientôt résolues. Tous nous pouvons beaucoup, si nous le voulons : faisons du moins ce que nous pouvons ; cela suffit.
Deuxièmement, l’excès
Nous pouvons travailler trop. On travaille trop, lorsque le travail extérieur se fait au détriment de l’intérieur, au détriment de notre conscience et de Dieu ; lorsque, absorbés par l’extérieur, nous négligeons de nous proposer une intention plus haute et surnaturelle ; lorsque nous nous adonnons à ces occupations sans mettre notre confiance au Dieu ; lorsque nous nous y attachons servilement, sans songer à l’éternité. Le travail, pris au sens véritable du mot et avec sa signification chrétienne, le travail exercé pour Dieu et pour le salut de notre âme, est une obligation et un honneur pour l’homme ; il est la condition de son progrès, et de son bonheur dans le temps et dans l’éternité. Au ciel, notre part sera en réalité celle que nous nous serons préparée par notre travail. Compris autrement, le travail perd toute sa signification ; il devient une divinité cruelle, un Moloch qui dévore le corps et l’âme de l’homme. Après tout – et c’est là qu’il faut en venir toujours – le travail est pour l’homme et l’homme est pour Dieu : il n’est donc pas un but, mais un moyen. Dès lors, afin de ne point faire fausse route dans notre travail, ménageons-nous, chaque jour, quelques instants pour nous recueillir et pour prier.
On le voit : saint Joseph est notre modèle tout indiqué en notre siècle où l’on fait du travail une idole. Par la juste mesure qu’il a su garder, par la sagesse avec laquelle il a uni la vie intérieure à la vie extérieure, il est le Patron des travailleurs et des ouvriers apostoliques ; disons mieux : il est le modèle de tous les hommes. Demandons-lui la grâce de l’imiter sur ce point : cette grâce est l’une de celles qui rentrent dans ses attributions.
Saint Joseph, dans la Vie de Jésus-Christ et dans la Vie de l’Eglise
R. P. M. Meschler S. I.