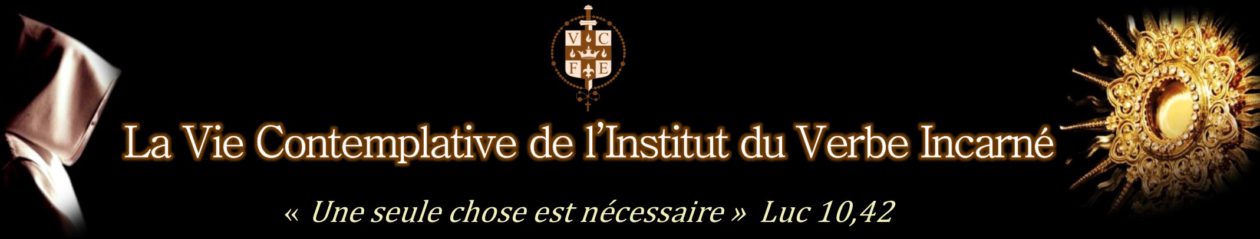La Vocation
Toutes les lectures que nous venons d’entendre peuvent nous mettre un peu mal à l’aise. Tous les détails qui sont lus sont profondément contre-culturels, à contre-courant.

Ainsi, par exemple, dans la première lecture, nous entendons l’appel d’Elisée qu’Elie choisit comme son successeur. C’est-à-dire que cette lecture du livre des Rois a un rapport direct avec la poursuite de sa vocation.
Maintenant, quand nous parlons de trouver notre propre chemin dans la vie, nous mettons un prix très élevé sur “notre jugement” sur ce qui nous convient ou ne nous convient pas de faire de notre vie – pour nous, cʼest comme un droit fondamental –, « personne ne vient me dire ce que je dois faire de ma vie, ʽje décideʼ quoi faire de ʽma vieʼ ». Eh bien, ce serait notre perspective, notre façon de penser dans la culture d’aujourd’hui, mais ce n’était certainement pas la perspective biblique.
Notez que l’Écriture ne suggère pas qu’Élie et Élisée se connaissaient. Soudain, Élie apparaît, passant devant lui pendant qu’il laboure, et soudain, sans lui demander, sans demander la permission, sans aucune discussion, sans préparation, Élie jette simplement son manteau sur lui et Elisée le suit (1 Rois 19,16b.19-21). Choisir son propre chemin? Décider quoi faire de sa vie? Cela ne semble pas être la voie biblique.
Notons aussi le changement qu’Elisée doit faire en acceptant son appel. Élisée était dans le champ en train de labourer avec douze paires de bœufs, c’est-à-dire qu’il était riche pour l’époque ou du moins de la « haute société», douze paires de bœufs font beaucoup d’animaux et, de plus, il avait des machines sophistiquées, la charrue; seules les personnes de la classe supérieure de la société pouvaient avoir de telles possessions. C’est comme si on disait aujourd’hui qu’Elisée conduisait sa Lamborghini. Que fait Elisée ? Immédiatement, il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service. Cela équivaut à dire « il a vendu toute son entreprise », « il a distribué tout son argent », « il a donné sa maison ». Imaginez! Une personne qui est riche, qui a des gens qui travaillent pour lui, qui a une grande maison, beaucoup de technologie dans son mode de vie, quitte tout d’un coup, donne tout.

Au cours des siècles, nous en avons vu beaucoup qui, comme Élisée, spontanément, à l’initiative de Dieu, ont tout quitté pour suivre notre Seigneur. Pensons, par exemple, à Saint Antoine l’Abbé qui, un jour, entra « par hasard » dans une église et entendit l’Évangile de Jésus dire au jeune homme riche : « va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Et il l’a fait ! alors qu’il était riche. Il passa le reste de sa vie à vivre dans la simplicité et l’austérité du désert. Pensez à Saint François d’Assise, qui était le fils d’un très riche marchand, il a tout donné et a même donné à son père les vêtements qu’il portait et s’est promené nu dans la forêt. Pensons à sainte Katherine Drexel, une sainte américaine, seule héritière d’une immense fortune, qui a tout quitté pour suivre l’appel de Dieu.
DON radical
J’imagine qu’à présent, vous pensez : « eh bien, nous en quelque sorte, plus ou moins, nous avons déjà fait cela » ; « Nous avons quitté le confort de nos maisons, notre argent – un peu ou beaucoup –, nos études… ». Cependant, et c’est là le but, comme religieux du Verbe Incarné, nous sommes appelés à une consécration radicale qui ne se termine pas le jour de la profession des vœux temporaires, ni le jour des vœux perpétuels, ni le jour de notre l’ordination sacerdotale, il faut « aspirer à vivre radicalement les exigences de l’Incarnation et de la Croix »[1] toujours, c’est-à-dire « vivre la pauvreté au degré maximum et absolu pour imiter mieux et plus radicalement le Christ pauvre »[2]. Et le grand séminaire doit être une école dans ce sens.
Pauvres, au sens matériel, on peut dire que vous l’êtes déjà… ici je me référerai plutôt à ce degré de pauvreté dont parle notre droit (de l’Institut du Verbe Incarné) et qui nous invite à conquérir “le détachement total, pas seulement des biens matériels – objet caractéristique de la vertu de pauvreté – mais de tout ce qui n’est pas Dieu lui-même, ce qui suppose la perfection de la charité et la sainteté complète et consommée »[3]. C’est très important pour notre vie de missionnaires.

Ici, vous n’avez pas douze bœufs, ni une Lamborghini, mais vous êtes entourés de beaucoup de consolations. Si vous y réfléchis bien, vous avez le bonheur d’être entourés de très bons prêtres vers qui vous pouvez aller quand vous voulez, vous avez accès quotidiennement aux sacrements, vous avez entouré de beaucoup de frères séminaristes, aucun d’entre vous – pas même celui qui habite le plus loin ici au séminaire – doit marcher des kilomètres pour aller à l’église, et nous pourrions donc continuer à énumérer plusieurs détails très consolants. Attention! Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, hein, au contraire, toutes ces choses sont très bonnes, elles sont très bonnes parce qu’elles conduisent à formation. Mais vous devez être vigilant et ne pas mettre votre cœur dans ces choses, car un jour Dieu va vous demander aussi un changement radical comme Elisée, et Dieu est dans son droit. C’est l’accord que nous avons conclu lorsque nous avons prononcé nos vœux dans cet Institut. Vous devez donc être préparés à cela.

C’est cela qui est arrivé, par exemple, à Saint Junipero Serra. A 56 ans et avec pour seule expérience d’avoir été professeur de théologie, très à l’aise au séminaire, il doit partir pour une mission qui lui paraît impossible dans le nouveau monde. Il a quitté sa zone de confort et il y est allé. Il a fondé 9 des 15 missions qui donnent aujourd’hui des noms aux villes de Californie. Cela lui a-t-il coûté ? Bien sûr, cela lui a coûté. Il était asthmatique et avait une blessure à la jambe qui n’a jamais guéri, mais il a marché jusqu’au bout (38 000 km). “Toujours en avant, jamais en arrière”, disait-il. C’est aussi arrivé à Saint Joseph d’Anchieta, qui venait de terminer le noviciat et même atteint de tuberculose, il fut envoyé à la mission au Brésil qui venait de commencer, avec toutes les difficultés que cela impliquait à ce moment-là. Il a fait son séminaire à la mission. Ses compagnons ont été ordonnés à 24, 25 ans, lui à 32 ans. Mais à l’appel de Dieu, ils n’ont pas reculé, ils n’ont pas regardé en arrière, ils se sont jetés dans ce que Dieu leur demandait.

Pour cette raison, notez que notre Directoire des Missions Ad Gentes établit comme condition très importante pour la mission cette capacité à se nier soi-même, à renoncer à cette attitude égoïste qui nous fait rechercher nos propres intérêts, notre propre confort, à travailler avec zèle dans le lieu et dans la charge que l’Institut nous confie pour la plus grande gloire de Dieu. Le Directoire dit ceci : « Il est demandé au missionnaire de ‘renoncer à lui-même et à tout ce qu’il avait jusque-là et de tout faire pour tous’ : dans la pauvreté qui le laisse libre pour l’Evangile ; dans le détachement des personnes et des biens de son propre milieu, pour devenir le frère de ceux à qui il est envoyé et les conduire au Christ Sauveur »[4]. Remarquez ce qu’il dit : renoncer à soi-même et à tout ce qu’il avait jusque-là… détachement des personnes et des biens de son milieu… cela fait partie du programme de tous ceux qui veulent être missionnaires dans l’Institut et ils doivent commencer à le pratiquer à partir de maintenant.
Il faut bien comprendre que pour être vraiment un tel missionnaire, il doit se donner tout entier, et il doit se donner pour toujours. C’est, et rien d’autre, l’idéal apostolique toujours promu dans l’Institut depuis sa fondation[5]. Rien n’est donné à moitié au Seigneur; rien n’est mesuré pour le Seigneur. C’est déjà si peu ce que nous pouvons lui offrir ! Donc, ne pas se donner pour toujours, c’est ne pas se donner du tout.
Une fois, saint Pierre Julián Eymard prêchait un sermon à ceux qui faisaient profession pour la première fois, alors il leur demanda : « Pour combien de temps signez-vous ce contrat ? Par prudence, la règle vous ordonne de ne le signer que pour quelques années, une ou trois. Allez-vous dire pour ça : Bon ! je me donne pour cette fois, mais plus tard on verra ? Il ne manquerait rien de plus! Dans votre cœur, vous devez prétendre que vous prononcez des vœux perpétuels. Car si ne voulez pas toujours appartenir à Dieu, vous n’êtes pas dignes d’être à lui pendant un an. Restez ici, leur dit le saint, ne faites pas un pas de plus, car quand il s’agit de Dieu, on n’essaye pas[6].
Cependant, il y a des âmes qui dès qu’une difficulté surgit, lorsqu’elles ont un doute dans l’apostolat, lorsqu’elles éprouvent un certain rejet -comme les disciples de l’Évangile lorsqu’ils n’ont pas été reçus-, lorsqu’elles sont corrigées, lorsqu’elles entendent quelques critiques contre l’Institut, remettent immédiatement en cause la suite du Christ, au point que parfois ces religieux se comportent en ennemis de la croix du Christ[7], comme le dit saint Paul, ils regardent en arrière comme dit l’Evangile que nous venons d’entendre. Parfois, pour éviter un renoncement, pour ne pas se nier, par peur du sacrifice, ils passent à côté de grandes grâces. Ils ont peur qu’en donnant quelque chose, il ne leur reste plus rien. Dites-moi une chose : pourquoi s’en tenir à une allumette quand on peut avoir le soleil ?
« Les lâches », dit notre droit, « meurent plusieurs fois avant leur mort »[8]. Rien de plus loin de nous. C’est pourquoi nous lisons dans un autre de nos documents : « La vocation religieuse est de tout quitter pour tout obtenir ; c’est quitter les choses de ce monde pour s’attacher au Tout qui est Dieu. Sainte Thérèse d’Avila disait : ” ce roi de gloire ne se rend et ne se donne qu’à celui qui se donne tout entier à lui “[9]. Loin de se lamenter sur ce que nous avons laissé, il faut considérer la bonté de Dieu qu’il veut se donner à nous »[10].

En ce sens, le témoignage d’un des martyrs nord-américains est vraiment exemplaire, Noël Chabanel, du même groupe que Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues… qui sont peut-être les plus connus. Le fait est que le père Chabanel était un enseignant prospère en France, mais il voulait ardemment être missionnaire en Nouvelle-France (Canada) et priait pour que son martyre soit accepté, c’est-à-dire son offre d’aller en mission dans ces terres. Le fait est que lorsqu’on a finalement envoyé et qu’il est arrivé à la mission, une fois qu’il a eu des contacts avec les Indiens et qu’il a eu l’occasion de vivre de première main les difficultés de la mission, il a voulu s’enfuir, retourner au confort et aux assurances de la France, à regarder en arrière. On dit que de tous les jésuites qui sont allés en Nouvelle-France, c’est à lui que la mission a coûté le plus. La langue lui était incompréhensible et le mode de vie lui répugnait et, naturellement, tout cela l’attristait. Cependant, et c’est là l’héroïsme qui le prépare au martyre, malgré le fait que ses supérieurs lui aient donné l’autorisation de rentrer en France, il a fait un vœu de rester ferme dans la mission coûte que coûte. Pourquoi? Parce qu’il était pleinement conscient des paroles que nous entendons prononcer au Verbe Incarné dans l’Évangile d’aujourd’hui : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »[11].
Et vous savez quoi? Dieu a pris le mot au sérieux. C’est lui qui a passé le plus de temps dans la mission, car il a été le dernier martyr. Une nuit, alors qu’il échappait à des guerriers indiens et essayait d’atteindre le poste de mission central que les jésuites avaient, il tomba sur une rivière très profonde qui ne pouvait pas être traversée à gué, et pendant qu’il réfléchissait à la façon dont il allait traverser, un indien – en fait un apostat chrétien – s’est approché de lui et lui a proposé de le faire traverser avec son canot. Mais à mi-parcours, il tue le père Chabanel, vole ce qu’il transporte et jette son corps dans la rivière. Il a fallu deux ans à l’homme pour avouer ce qu’il avait fait, disant qu’il avait agi par haine des missionnaires et de la foi. Vous comprenez ? S’il était revenu dans le confort et la sécurité de la France, s’il était revenu dans sa zone de confort, il aurait perdu la palme du martyre et de la béatitude éternelle.
C’est pourquoi il est important maintenant que vous êtes en formation que vous portiez vos sacoches bien remplies de ferveur, la ferveur qui résiste aux grandes vagues d’épreuves qui s’abattront sans doute sur le missionnaire; que vous portent leurs sacoches bien remplies de « charité apostolique »[12] – comme nous demande le droit propre – qu’ils fassent oublier au missionnaire lui-même pour travailler « même dans les lieux les plus difficiles et dans les conditions les plus défavorables »[13] et ce pas en aucune façon, mais avec un grand zèle pour le bien des âmes et l’expansion de l’Église du Christ; et être rempli de ce courage qui fait le missionnaire – même s’il n’a plus les consolations spirituelles qu’il avait auparavant « et qu’un jour Dieu se retire complètement »[14] et aussi dépouillé « du soutien et des assurances concernant l’état de son âme »[15] – de même ayez confiance « avec une fermeté inébranlable que même les événements les plus défavorables et contraires à votre vision naturelle sont ordonnés par Dieu pour votre bien »[16].
Le génie de San Alberto Hurtado disait : “Dans la vie il n’y a pas de difficultés, il n’y a que des circonstances. Dieu conduit tout, et tout conduit bien. Il n’y a plus qu’à s’abandonner, et servir à chaque instant dans la mesure du possible ».

Regarder vers l’avant
Pour cette raison, écoutez-moi bien, il y a eu des difficultés et il y en aura toujours, des critiques, des menaces, des croix de toutes sortes ne manquent pas et ne manqueront pas car Dieu ne veut pas qu’elles manquent, ni ici ni ailleurs. Cependant, il faut regarder vers l’avant, il faut aller au large, confiant dans la parole du Christ : Duc in altum ! Jésus lui-même nous avertit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »[17]. Dans la cause du Royaume, il n’y a pas de temps pour regarder en arrière, et encore moins pour se laisser emporter par la paresse. On attend beaucoup de nous : en concret la tâche sublime de « conquérir pour Jésus Christ tout ce qui est authentiquement humain, surtout dans les situations les plus difficiles et la plus grande adversités »[18]. Nous devons agir généreusement[19], résolument[20], « toujours en travaillant contre la tentation de la procrastination, contre la peur du sacrifice et de l’abandon total, et contre la tentation de récupérer ce que nous avons donné en cherchant une compensation ou en nous installant, en faisant un “nid” dans des choses qui ils ne sont pas Dieu »[21]. C’est l’exemple du Christ lui-même dans l’Évangile d’aujourd’hui qui dit que Jésus se dirigea résolument vers Jérusalem[22]. Et dans cette « attitude il faut vivre tout le temps, sans amoindrissement ni recul, sans réserves ni conditions, sans subterfuges ni retards, sans reculs ni lenteurs »[23]. Car « il n’est pas capable de bâtir des empires qui n’est pas capable d’incendier ses navires en débarquant »[24].
Conclusion

Demandons dans cette Sainte Messe la grâce que sortent de cette bien-aimée maison de formation des missionnaires qui vivent la seigneurie sur eux-mêmes, sur les hommes, sur le monde et sur le diable; qu’ils jouissent de la ‘liberté’ des enfants de Dieu… qu’ils sont courageux, qu’ils sont habitués à la discipline, qu’ils savent valoriser chaque chose et de manière hiérarchisée ; qui aiment l’Institut en vivant leur propre charisme, des missionnaires qui disent avec toute la radicalité et l’engagement que cela implique : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ! »[25].
Nous demandons cette grâce au Verbe Incarné par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie.
[1] Constitutions, 20.
[2] Constitutions, 70.
[3] Constitutions, 68.
[4] N° 163.
[5] Bienheureux Paolo Manna, « Vertus apostoliques », Lettre circulaire n. 15, Milan, 15 avril 1931.
[6] Œuvres eucharistiques, 5e série, Exercices spirituels donnés aux religieux de la Congrégation des Frères de Saint Vincent Paul, p. 955.
[7] Directoire de Spiritualité, 138 ; Op.cit. FL 3.18.
[8] Directoire de Spiritualité, 76.
[9] Voie de perfection, ch.16, 4.
[10] Directoire de Vocations, 52.
[11] Luc 9,62.
[12] Directoire de Missions Ad Gentes, 164 ; Op.cit. Redemptoris missio, 89.
[13] Constitutions, 30.
[14] Directoire de Spiritualité, 178.
[15] Voir ibid.
[16] Directoire de Spiritualité, 67.
[17] Luc 9,62.
[18] Constitutions, 30.
[19] Directoire de Vocations, 23.
[20] Idem.
[21] Voir Directoire de Spiritualité, 16.
[22] Luc 9.51.
[23] Directoire de Spiritualité, 73.
[24] Idem.
[25] Luc 9,57.