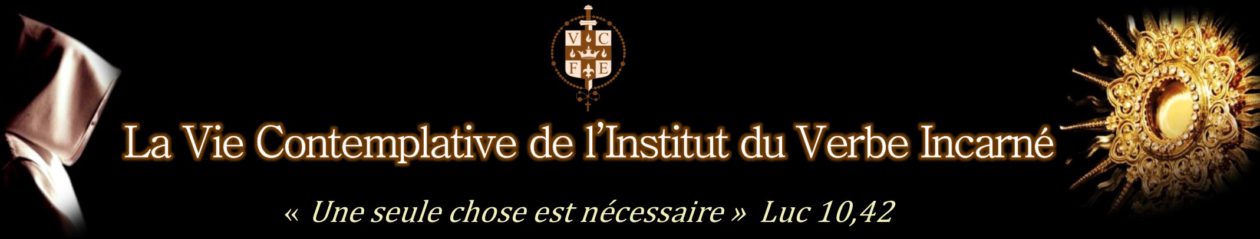Homélie pour le Dimanche XXXIII, année B (Mc 13, 24-32).
Ce dimanche, l’Eglise conclut la méditation de l’évangile de saint Marc, que nous avons suivi le long de cette année liturgique, et comme chaque année, le dernier texte évangélique à méditer, avant la fête de Christ Roi, nous parle de la fin des temps, il s’agit d’un discours prophétique du Seigneur et il consiste dans la description des signes qui vont précéder sa venue, des signes qui seront concrets et visibles mais aussi représentatifs d’une autre réalité ; nous ignorons si ces signes se réaliseront tous au même moment, car le Seigneur dit « en ces jours ».
Mais si nous affirmons que la Parole du Seigneur est véridique, et que ces signes vont nécessairement s’accomplir dans l’histoire de l’humanité, nous devons aussi considérer la valeur relative de ses signes, ils ne constituent pas la partie essentielle de ce message ; c’est plutôt la venue de notre Seigneur, qui est décrite avec tous les signes de la majesté divine.
Après cette prophétie, le Seigneur nous propose une parabole. Si les hommes ont la capacité de reconnaître un changement de saison par les signes de la nature, les chrétiens auront aussi la capacité de découvrir par des signes visibles la venue dans la gloire du Christ.
Il y a pourtant, des expressions dans ce texte que nous devons essayer de bien comprendre ; en cas contraire, on peut tomber dans des grosses erreurs d’interprétation. Le bon chemin d’interprétation se trouve chez les pères de l’Eglise, les grands saints de la première époque de l’Eglise qui ont lu et interprété, les premiers, les Ecritures, surtout l’évangile.
D’abord, le Seigneur, lorsqu’il annonce les signes dit : « Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive ». Ainsi, certains ont considéré que le Seigneur pensait que la fin du monde arriverait subitement quelque temps après son Ascension et que le Seigneur s’était « trompé ». La réponse de tout bon chrétien, qui croit ce que Jésus-Christ qui a dit et qui est la Vérité même, doit être évidement toute autre.
Nous avons deux aspects à relever dans cette phrase : le premier, lorsque le Seigneur déclare cette prophétie sur la fin du monde, il prophétise aussi la fin tragique de Jérusalem, on peut dire que les deux prophéties sont superposées et que la prophétie de la destruction de Jérusalem est une image concrète de la fin de l’histoire humaine pour les disciples. L’expression « cette génération » désigne d’abord ces disciples qui allaient vivre ce moment de l’histoire d’Israël de la destruction de sa capitale et de son unique temple , qui sera une image de la fin de tous les temps. L’autre bonne interprétation de ces paroles est celle que soutiennent aussi les pères de l’Eglise, « cette génération » indique le nouveau peuple de Dieu, les disciples du Christ, ceux qui ont cru en Lui et qui attendront sa venue durant toute l’histoire de l’humanité, c’est-à-dire les vrais croyants.
L’autre expression à bien comprendre est celle-ci : « Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. ». Sur ces paroles se sont appuyés certains hérétiques dans l’histoire pour nier que Notre Seigneur eût le même pouvoir que le Père, c’est-à-dire qu’Il partageait la même gloire et dignité, qu’il est consubstantiel au Père. En définitive, ces hérétiques disaient que ces paroles démontraient que Jésus ne connaissait pas tout, qu’il lui manquait quelque chose pour être égal au Père.
Ecoutons l’explication donnée par saint Thomas d’Aquin, s’appuyant sur saint Augustin et saint Jérôme : « On peut dire que le Fils sait et que le jour du jugement a été déterminé selon une certaine raison, et que ce qui a été déterminé par Dieu a été déterminé par son Verbe éternel. Il est donc impossible que le Fils ne sache pas. Mais pourquoi [le Seigneur] dit-il qu’il ne sait pas ? Saint Augustin et Saint Jérôme disent que, selon la façon habituelle de parler, on dit « ne pas connaître quelque chose » lorsqu’on ne le fait pas connaître. Ainsi, il est dit en Gn 22, 12 : Maintenant, je sais que tu crains Dieu, c’est-à-dire : «J’ai fait connaître.» On dit ainsi que le Fils ne sait pas parce qu’il ne fait pas savoir.
Alors, notre devoir comme des bons chrétiens est de nous intéresser, non au moment mais plutôt à l’essentiel de la deuxième venue du Seigneur ; car cette deuxième venue sera dans la gloire mais pour juger les actions de tous les hommes, vérité que nous confessons, lorsque nous disons que Notre Seigneur est monté au Ciel et que delà il viendra de nouveau mais pour juger les vivants et les morts. Sommes-nous préparés pour ce moment ? Mais nous savons aussi que ce dernier moment de l’histoire sera précédé par un autre moment éternellement décisif, notre propre mort et le jugement personnel devant le Christ.
Ecoutons et méditons ces paroles du pape Benoît : « Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point » (v. 31). En effet, nous savons que dans la Bible, la Parole de Dieu est à l’origine de la création : toutes les créatures, à commencer par les éléments cosmiques — soleil, lune, firmament — obéissent à la Parole de Dieu, elles existent parce qu’elles sont « appelées » par elle. Cette puissance créatrice de la Parole de Dieu s’est concentrée en Jésus Christ, le Verbe fait chair, mais elle passe aussi à travers ses paroles humaines (les Saintes Ecritures), qui sont le vrai « firmament » qui oriente la pensée et le chemin de l’homme sur terre. C’est pourquoi Jésus ne décrit pas la fin du monde, et quand il utilise des images apocalyptiques, il ne se comporte pas en « voyant ». Au contraire, Il veut soustraire les disciples de chaque époque à leur curiosité pour les dates, les prévisions, en leur donnant en revanche une clef de lecture profonde, essentielle, et surtout leur indiquer le juste chemin à suivre, aujourd’hui et demain, pour entrer dans la vie éternelle. Tout passe — nous rappelle le Seigneur —, mais la Parole de Dieu ne change pas, et face à elle chacun de nous est responsable de son propre comportement. C’est sur cette base que nous serons jugés. » (Angélus, 18/11/12)
Comment devons-nous attendre ce moment du Jugement, soit celui de notre histoire (après la mort) ou bien celui de l’histoire de l’humanité à la fin du temps. Selon saint Thomas d’Aquin, nous devons utiliser quatre remèdes contre la crainte du jugement (Commentaire du Credo).
Le premier consiste dans les bonnes œuvres. Saint Paul en effet écrit aux Romains (13, 3): Veux-tu n’avoir pas à craindre l’autorité? Fais le bien et tu en recevras des éloges.
Le second remède contre la crainte du jugement, c’est la confession et la pénitence des péchés que l’on a commis. Pour cette confession et cette pénitence, trois conditions sont requises, grâce auxquelles la peine éternelle est expiée, ce sont la douleur dans la pensée, la honte dans l’aveu, la rigueur dans la pénitence.
Le troisième remède est l’aumône qui purifie tout. Le Seigneur a dit à ses disciples (Luc 16, 9) « Avec l’argent malhonnête, faites-vous des amis, pour que, le jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous reçoivent dans les tentes éternelles. »
Le quatrième remède contre la crainte du jugement c’est la charité, c’est-à-dire l’amour de Dieu et du prochain : la charité, en effet, fait disparaître la multitude des péchés (I Pierre 4, 8 et Prov. 10, 12).
Comme conclusion, nous affirmons que « le jour et l’heure personne ne le connaît ». Dieu a caché le moment et cela fait aussi fait partie de son plan infiniment sage et aimant. Ce n’est pas pour nous surprendre, comme s’il cherchait notre damnation. Ce qu’il cherche, c’est que nous soyons vigilants, attentifs, « afin que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur » (1Tes 5,4). Il ne s’agit pas de peur, mais d’amour. C’est une attente faite de désir, voire d’impatience. Le vrai chrétien est celui qui “aspire à sa venue” (2Tm 4,8).
«Que personne ne prétende connaître le dernier jour, enseigne le grand saint Augustin, c’est-à-dire quand il arrivera. Mais soyons tous éveillés par une vie droite, afin que notre dernier jour particulier ne nous surprenne pas, car de la manière dont l’homme a quitté son dernier jour, c’est ainsi qu’il se retrouvera dans le dernier jour du monde. Ce seront ses propres œuvres qui élèveront ou opprimeront chacun homme… Qui d’entre nous n’ignore qu’il est dommage de devoir nécessairement mourir et, ce qui est pire, sans savoir quand ? La peine est vraie et le temps incertain ; et, des choses humaines, seulement de cette peine (de savoir que nous allons mourir) nous avons une certitude absolue” (Sermon 97, 1-2).
Que la Très sainte Vierge Marie nous donne la grâce d’être toujours prêts pour le moment de notre rencontre avec le Seigneur.
P. Luis Martinez IVE.