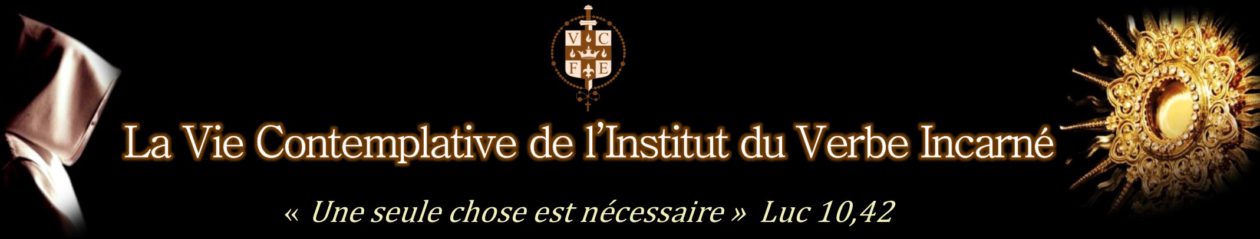Homélie pour le Dimanche XXV , année C (Lc 16, 1-13)
Ce dimanche, l’Evangile nous invite à considérer et à réfléchir à ce grand obstacle pour le salut et la sanctification des chrétiens que constitue l’affection pour les richesses.
Mais, remarquons bien que nous parlons d’affection pour les richesses et non de la seule possession. En effet, le fait d’avoir des richesses n’est pas un péché en soi, si vraiment elles ne possèdent pas le cœur de la personne. Par contre, si nous n’avons pas de grandes richesses mais si notre cœur est toujours dans l’envie de les avoir, cela constitue vraiment un péché contre le dixième commandement.
Le problème se pose donc lorsque les biens matériels cessent d’être un moyen pour devenir le but de notre vie.

L’évangile de ce dimanche commence par raconter une histoire, c’est une parabole qui suscite en nous un certain étonnement, parce que l’on parle d’un intendant malhonnête dont on fait louange.
Dans cette parabole, il faut bien comprendre ce que le Seigneur veut nous laisser comme enseignement, parce qu’Il ne nous présente pas ce gérant « rusé » comme un modèle à suivre dans la malhonnêteté, mais plutôt comme un exemple à imiter pour sa capacité à agir de manière avisée ; c’est son astuce qui est louée. En fait, la parabole finit avec ces mots : “Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ” (Lc. 16, 8).
Nous ne devons pas interpréter à notre façon humaine les paraboles de Jésus, il nous faut plutôt les comprendre du point de vue divin, c’est une logique divine et surnaturelle. A partir de cela, la clé de lecture et l’interprétation doivent être toujours en relation avec notre vie spirituelle.
On peut dire donc, en appliquant les images de cette parabole, que l’administration c’est le temps de notre vie : dans le temps que Dieu nous donne en ce monde, le patron c’est Dieu et le gérant c’est nous-mêmes, les biens à administrer ce sont tous les biens que Dieu a mis entre nos mains qui ne sont pas à nous parce que tout appartient à Dieu, c’est Lui qui nous les a donnés pour qu’ils fructifient pour la vie éternelle, cela signifie savoir les gérer pour se faire des amis avec « l’argent malhonnête », ce mot fait référence au livre de l’Ecclésiastes (5, 10), il désigne plutôt des richesses de ce monde, « afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles ». Les riches aident les pauvres dans ce monde et les pauvres aident les riches dans le monde à venir, disaient les savants juifs.
Et voilà la raison des autres avertissements du Seigneur sur notre conduite par rapport à l’argent et aux biens de ce monde. Ce sont de petites phrases qui invitent à un choix et qui présupposent une décision radicale.

La conclusion du passage évangélique est claire, il n’y a pas trop à interpréter ici : “Nul serviteur ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre”. En définitive, dit Jésus, il faut se décider : “Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon” (Lc 16, 13).
« Mammon » est un terme d’origine phénicienne, c’était l’idole de la richesse et de la bonne réussite dans la vie ; c’était une petite idole que les gens portaient sur eux pour attirer le bonheur. Le mot désignait la bonne réussite économique et le succès dans les affaires ; mais avec le temps il est devenu le synonyme du mot argent, et nous retrouvons le même mot pour signifier les richesses ; ici à Carthage, selon saint Augustin les carthaginois utilisaient le nom « mammon » pour définir les richesses.
On peut dire que l’argent devient l’idole à laquelle on sacrifie toute chose pour atteindre sa propre réussite matérielle. Aujourd’hui, les nouveaux païens ne portent plus la statue, mais l’idole est dans leur cœur.
Il y a un dicton qui dit : l’argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, lorsqu’il domine le cœur, l’argent peut nous conduire à la perdition éternelle. Il faut donc parler de l’argent, mais l’argent comme un moyen pour un but et comme contrepartie, le danger est de faire de l’argent et des richesses le but dans notre vie.
L’argent est une créature, voulue par Dieu, il est utile pour inter-changer les biens, c’est un moyen. Sa valeur est déterminée par la société.
- De la façon dont la personne se le procure : cela peut être dans l’honnêteté ou en cas contraire, à travers la fraude ou la tromperie.
- De la façon dont la personne le gère, l’argent peut avoir une valeur de moyen pour un but plus haut, ou, dans le cas contraire, la personne devient esclave de l’argent ou des richesses.
Seulement lorsque l’argent fait référence à une personne, il peut devenir un bien ou un mal :
Quelle est donc la façon correcte et juste d’utiliser les richesses ?

Lorsque nous leur donnons la vraie valeur qu’elles ont, un moyen et non un but.
Nous pouvons nous en servir pour le bien de nous-mêmes et de notre famille ou pour le bien du prochain. Enumérons comme critères : l’utiliser dans les dépenses obligatoires (nourriture, santé, logement, c’est-à-dire les besoins basiques de tout être humain), dans les exigences sociales (payement d’impôt et services), dans les économies qu’on peut faire en vue des besoins futurs (sans manquer en la confiance envers la Divine Providence), dans les dépenses que je dois faire envers le prochain, surtout lorsque les autres sont vraiment dans la nécessité ; dans le cas contraire, ne pas les aider en ayant les moyens de le faire constitue un péché, comme dit le livre des Proverbes (28,27) : « Qui donne au pauvre ne manquera de rien ; qui détourne les yeux sera chargé de malédictions ».
Une fois que ces critères sont respectés, nous pouvons consacrer une somme rationnelle et juste d’argent pour les loisirs (vacances, recréation), toujours en gardant la modération dans ces dépenses afin qu’ainsi recréer notre esprit et notre corps ne soit pas contraire à la loi de Dieu.

Mais, il existe comme, pour toute créature le risque de nous attacher à l’argent ou de se le procurer ou à l’utiliser de façon contraire à loi de Dieu. « La racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent, nous dit saint Paul. Pour s’y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-mêmes des tourments sans nombre » (1Timothée 6,10). Lorsque, par exemple, le fait d’avoir un revenu plus haut devient la règle exclusive et l’unique finalité de toute activité économique.
Un autre cas d’abus lié à l’envie des richesses c’est lorsque les personnes sont considérées comme de simples objets ou machines avec une seule valeur économique. C’est-à-dire, qu’une personne n’aurait de valeur que seulement lorsqu’elle peut gagner de l’argent.
Le fait de se procurer de l’argent, de ne vivre que pour avoir des biens, cause une sorte d’esclavage chez les hommes, qui adorent le dieu Mammon et ils sacrifient à lui le temps, la famille, les valeurs essentielles de la vie et la même vie aussi.
L’envie de l’argent devient un vice qui attrape la volonté jusqu’à faire « perdre la tête pour lui », « l’avare ne sera jamais rassasié d’argent » (Si 5, 9).
Mais, malheureusement, l’idolâtrie de l’argent pénètre aussi dans nos vies. Lorsque nous donnons plus de valeur à une personne pour ce qu’elle possède (avoir) que pour ce qu’elle est (l’être), ainsi certains pensent qu’un individu vaut la quantité d’argent qu’il gagne.
Lorsque nous pensons qu’avoir un salaire élevé signifie la réalisation personnelle ou bien que le fait de posséder des richesses nous donnerait un certain statut social par rapport aux autres. Sans oublier que l’envie de l’argent et des richesses nous rend égoïste et ferme notre cœur devant les besoins d’autrui, ce qui produit toujours des séparations et des disputes même aux seins de meilleures familles.

Devant les séductions du monde qui pousse à adorer l’idole de l’argent et qui vit selon les lois que cette idole lui dicte, nous ne devons pas oublier ce que nous enseigne saint Paul (Rom. 12,2) : « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait ». Que Marie nous donne cette grâce.
P. Luis Martinez IVE.