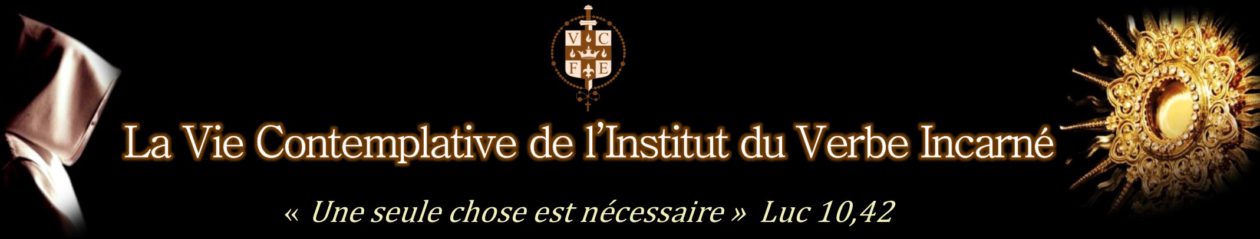Solennité de l’Epiphanie de Notre Seigneur
Nous célébrons aujourd’hui le mystère de l’Epiphanie, un mot d’origine grecque composé par la particule « Epi » qui veut dire « sur » tandis que « phania » dérive du verbe phaino « illuminer, briller » ; on peut donc dire qu’il faisait référence à tout ce qui se manifestait, ce qui attirait l’attention, de la qu’Epiphanie est traduit dans les langues latines avec le mot « Manifestation ».
En fait, cette fête tient son origine dans la révélation de l’Enfant Jésus, l’Enfant Jésus se manifeste, se révèle aux hommes, spécialement à ces rois mages, si bien qu’Il s’était déjà manifesté aux bergers, et plus tard aussi au juste Siméon et à la prophétesse Anne dans le temple.
Mais l’évangile centre son attention et aussi la liturgie sur les mages venus d’Orient. L’évangile nous dit qu’ils étaient « mages », et ce mot, auquel nous sommes aussi habitués traduit, ou plutôt il est une translitération du mot persan « magousai ou magis », et il désignait plutôt des sages, qui réunissaient et avaient une connaissance de toutes les sciences du savoir ( philosophie, astronomie, médecine). La tradition nous dit qu’ils étaient aussi des rois d’Orient, et cela est dû à une application directe de la première lecture qui est une prophétie de ce mystère : Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. En tout cas, rien n’empêche de dire qu’ils étaient peut être aussi des rois. Ils étaient des personnages importants pour leur temps, lorsqu’ils entreprennent un long voyage, pour lequel il fallait aussi compter avec les moyens nécessaires.

Pour nous, le plus important c’est de savoir que nous sommes tous représentés en eux. Nous sommes tous vénus du peuple gentil, dans le sens dont parle l’apôtre Paul pour dire qu’on ne provient pas directement de la race juive.
Comme on a dit le Seigneur se manifestait dans sa naissance, mais pas à tous les hommes, Dieu a choisi ceux auxquels la Nativité de son Fils devait se révéler. Et dans ce choix il s’était manifesté, en quelque sorte, à toutes les catégories d’hommes.
Saint Paul dit (Col 3, 11), ” dans le Christ Jésus il n’y a plus ni homme ni femme, ni païens ni Juifs, ni esclaves ni homme libre “. Et pour que cela soit préfiguré dans la naissance même du Christ il a été manifesté à des hommes de toutes conditions. Parce que, dit S. Augustin, ” les bergers étaient des Israélites et les mages des païens. Les uns habitaient tout près, les autres venaient de loin. Il y a eu entre eux d’autres différences : les mages étaient sages et puissants, les bergers ignorants et simples. Il s’est aussi manifesté à des justes comme Siméon et Anne, et à des pécheurs comme les mages ; il s’est encore manifesté à des hommes et à des femmes, comme Anne, pour montrer que nulle condition humaine n’est exclue du salut du Christ.
Ces trois rois, qui habitaient à l’Orient, se mettent en marche vers le Seigneur. Ils seront guidés par une étoile qui est devenue, elle aussi un peu notre symbole de Noël.
Voyons que Dieu utilise avec les différentes personnes avec qui Il manifeste sa Nativité selon la façon dont chacun pouvait la recevoir et était habitué à le faire. Par exemple, pour Siméon et Anne, des justes selon l’Ecriture, ils étaient habitués donc à recevoir les messages de Dieu par l’inspiration de l’Esprit Saint, à eux Dieu leur parle directement au cœur. Aux bergers, qui connaissaient l’histoire du peuple d’Israël, ils savaient parfaitement que c’était à travers les anges que Dieu annonçait les grands évènements à son peuple, le message de la nativité du Messie vient à travers l’annonce de l’Ange. Tandis que finalement, les mages, païens habitués à regarder les corps célestes, Dieu va les guider par une étoile.

Alors, comment était cette étoile qui les guide ? : L’etoile n’était pas comme l’une des étoiles que nous contemplons dans notre ciel, mais plutôt c’était un astre nouveau apparu pour l’enfantement nouveau d’une vierge. En fait elle ne se trouvait dans le ciel, mais dans l’air proche de la terre, et elle se mouvait selon la volonté de Dieu.
Et Saint Jean Chrysostome nous donne de nombreux indices qui manifestent cela.
1° Aucune autre étoile ne suit cette direction, car celle-ci se portait du nord au midi; c’est en effet la situation de la Judée par rapport à la Perse, d’où les mages sont venus.
2° C’est évident quant au temps. Car non seulement cette étoile apparaissait la nuit, mais aussi en plein jour. Ce qui n’est au pouvoir d’aucune étoile, ni même de la lune.
3° Parfois elle se montrait et parfois elle se cachait. En effet, quand les mages entrèrent à Jérusalem elle se cacha ; ensuite, quand ils quittèrent Hérode, elle se montra.
4° Elle n’avait pas un mouvement continu, mais quand il fallait que les mages se mettent en marche, elle marchait, et quand ils devaient s’arrêter, elle s’arrêtait.

5° Elle ne montrait pas seulement l’enfantement de la Vierge en demeurant en l’air, mais aussi en descendant. On lit en effet (Mt 2, 9): ” L’étoile qu’avaient vue les mages à l’orient les précédait jusqu’à ce qu’elle s’arrêtât au-dessus du lieu où était l’enfant. “
Nous allons conclure encore avec une petite remarque, malheureusement la traduction de notre texte liturgique n’est pas tout à fait fidèle au texte originel. En effet, les rois disent à Hérode « Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus « l’adorer », mais le texte de la liturgie dit « nous prosterner devant lui ». De même pour le moment où ils trouvent l’Enfant et sa Mère, « tombant à ses pieds, ils adorent l’Enfant » Et il est nécessaire de préciser cela, parce que on peut se prosterner devant une personne humaine, par exemple un roi, tandis que l’adoration est seulement due à Dieu.
Le roi qu’ils cherchent est au même temps, un Dieu, le Dieu tout puissant. Et c’est pour nous le plus important, ces gens qui n’appartenaient pas au peuple d’Israël sont illuminés par Dieu, Dieu vient les chercher avec un signe, comme on a dit, qui leur était familier, mais Il les guide pour adorer le vrai Dieu, et dans les cadeaux qu’ils lui offrent nous est aussi révélé la vérité de cet Enfant.
Comme nous explique Saint Jean Chrysostome, ” si les mages étaient venus chercher un roi de la terre, ils auraient été déçus; car ils auraient supporté sans raison la fatigue d’un si long trajet “. Mais, cherchant le roi du ciel, ” quoique ne voyant rien en Jésus de la dignité royale, ils se contentèrent cependant du témoignage de l’étoile, et ils l’adorèrent “. En effet, ils voient un homme et ils reconnaissent Dieu. Et ils offrent des présents accordés à la dignité du Christ. ” L’or, comme au grand Roi ; l’encens, qui sert dans les sacrifices divins, comme à Dieu; la myrrhe, dont on embaume les corps des défunts, comme à celui qui doit mourir pour le salut des hommes. “
Saint Grégoire nous dit encore : Nous apprenons par-là ” à offrir au Roi nouveau-né l’or “, qui symbolise la sagesse, ” lorsque nous resplendissons en sa présence de la lumière de la sagesse; l’encens ” qui exprime le don de soi dans la prière, ” nous l’offrons quand, par l’ardeur de notre prière, nous exhalons devant Dieu une bonne odeur; et la myrrhe, qui symbolise la mortification de la chair, nous l’offrons si nous mortifions nos vices charnels par les sacrifices “.

Renouvelons donc la grâce de la prière collecte: nous le connaissons déjà par la foi, qu’il nous conduise jusqu’à la claire vision de sa splendeur. Et demandons aussi la grâce pour ceux qui n’ont pas encore connus le Christ qu’ils viennent dans sa véritable maison, qui est l’Eglise aussi l’adorer comme Dieu.
P. Luis Martinez IVE.