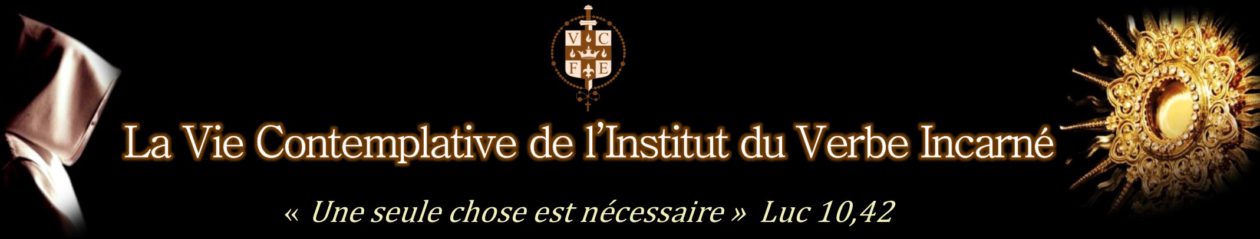1. Millénaire de la fête des morts

Le 12 octobre, Jean-Paul II adresse un message à l’évêque français Raymond Séguy, d’Autun, Chalon et Mâcon, et abbé titulaire de Cluny, à l’occasion des cérémonies commémorant le millénaire de la fête des Morts, instituées par saint Odilon, Moine bénédictin et cinquième abbé de Cluny.
Jean-Paul II rappelle que « Saint Odilon voulait exhorter ses moines à prier d’une manière particulière pour les défunts. A partir de l’abbé de Cluny, la coutume d’intercéder solennellement pour les défunts se répand et devient ce que saint Odilon appelle la fête des morts, pratique toujours en vigueur aujourd’hui dans l’Église universelle.
“En priant pour les morts – écrivait le Saint-Père -, l’Église contemple avant tout le mystère de la Résurrection du Christ qui, par sa Croix, nous obtient le salut et la vie éternelle. L’Église espère dans le salut éternel de tous ses enfants et de tous les hommes.
Après avoir souligné l’importance des prières pour les morts, il écrit : « Les prières d’intercession et de supplication que l’Église ne cesse d’adresser à Dieu ont une grande valeur. Le Seigneur est toujours ému par les supplications de ses enfants, car il est le Dieu des vivants. L’Église croit que les âmes du purgatoire “sont aidées par l’intercession des fidèles, et surtout, par le sacrifice propitiatoire de l’autel”, ainsi que “par la charité et d’autres œuvres de piété”.

Enfin, le Pape encourage les catholiques « à prier avec ferveur pour les défunts, pour leurs familles et pour tous nos frères et sœurs décédés, afin qu’ils reçoivent la rémission des peines dues à leurs péchés et qu’ils entendent l’appel du Seigneur. “[1]
2. Du celtique Samain à Halloween, en passant par les défunts
Le 31 octobre au soir, dans les pays de culture anglo-saxonne ou d’héritage celtique, on célèbre la veille de la Toussaint, avec tout un décor qui rappelait autrefois les morts (puis avec l’arrivée du christianisme, les âmes du purgatoire) et qui est maintenant devenue une salade mentale dans laquelle les croyances en sorcières, fantômes et autres ne manquent pas. En revanche, dans les pays de culture méditerranéenne, la mémoire du défunt et l’attention à la mort sont centrées sur le 2 novembre, au lendemain de la célébration de la résurrection et de la joie du paradis qui attend la communauté chrétienne, « une famille de saints » comme saint Paul l’entendait.
Diverses traditions se côtoient, se mélangent et s’influencent en ce début novembre dans les cultures des pays occidentaux. En Asie et en Afrique, le culte des ancêtres et des morts a de fortes racines mais il n’est pas aussi lié à une date précise que dans notre culture.

Un antécédent de cette fête se retrouve chez les Romains qui célébraient les « Lémuries » en mai et pratiquaient divers stratagèmes pour éloigner les fantômes et surtout s’en faire des amis. Les racines de la fête actuelle remontent au 7ème ou 6ème siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Celtes, précisément le 31 octobre, célébraient Samain, le nouvel an. Ils croyaient que les morts revenaient sur terre et, pour célébrer leur retour, ils allumaient de grands feux de joie et préparaient de grandes quantités de nourriture. La vieille croyance mêlée de superstitions a atteint les États-Unis et a commencé à faire partie du folklore autonome. La citrouille, ajoutée plus tard, trouve son origine dans les pays scandinaves puis est revenue en Europe et dans le reste de l’Amérique grâce à la colonisation culturelle de ses médias et à l’importation de téléfilms et de films.
Depuis quelques années, elle fait fureur chez les adolescents méditerranéens et latino-américains qui oublient leurs riches traditions pour adopter la calebasse creuse illuminée. A Hallowe’en (de All Hallow’s Eve), littéralement All Hallows’ Eve, la légende anglo-saxonne dit qu’il est facile de voir des sorcières et des fantômes. Les enfants se déguisent et vont – avec une bougie insérée dans une gourde évidée dans laquelle des incisions sont faites pour former un crâne – de maison en maison. Lorsque la porte s’ouvre, ils crient : ‘trick or treat’ (blague ou cadeau) pour indiquer qu’ils feront une blague à celui qui ne leur donnera pas une sorte de pourboire ou de bonus en bonbons ou en argent.

Une vieille légende irlandaise raconte que la citrouille illuminée serait le visage d’un certain Jack O’Lantern qui, le soir de la Toussaint, invita le diable à boire dans sa maison, se faisant passer pour un bon chrétien. Comme il était un homme dissolu, il a fini dans l’enfer.
Avec l’arrivée du christianisme, alors que dans les pays anglo-saxons se dessine le cortège d’enfants déguisés mendiant de porte en porte avec la lanterne en forme de crâne, en Méditerranée d’autres coutumes liées aux 1er et 2 novembre se répandent. Dans de nombreuses villes espagnoles, il y a une tradition d’aller de porte en porte pour jouer, chanter et demander de l’argent pour les « âmes du purgatoire ». Aujourd’hui, bien que moins que par le passé, les cimetières sont toujours visités, les tombes sont ornées de fleurs, les parents décédés sont commémorés et priés pour eux ; dans les maisons on parlait de la famille, de tous les vivants et de ceux qui étaient passés à une autre vie et on consommait des sucreries spéciales, qui durent pour l’occasion, comme en Espagne les beignets de vent ou les os de saint.

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’océan et dans le sud des États-Unis, la tradition catholique portée par les Espagnols et les Portugais se teintait de sa propre couleur dans chaque pays américain, mêlée aux rites précoloniaux locaux et au folklore du lieu. Le Mexique est l’un des pays où la fête de la Toussaint a pris plus de force et de couleur.
Beaucoup se déguisent en morts ou portent des masques de crâne et mangent des bonbons en forme de crâne ou de squelette. En ce sens, les évêques de deux diocèses mexicains voisins des États-Unis, Sonora et Sinaloa, ont attiré l’attention sur l’influence américaine qui provoque la perte des traditions indigènes et encourage le consumérisme et l’imitation d’une tradition aujourd’hui plus païenne que chrétienne. L’archevêque d’Hermosillo, José Ulises Macías, a déclaré que “nous, les Mexicains, devons nous enraciner dans nos propres coutumes riches et amusantes, car chaque nation a ses festivités en fonction de ses événements historiques et sociaux”.

Certes, en Galice, deux traditions se rejoignent : la celtique et la catholique, c’est pourquoi c’est la région d’Espagne où la tradition du souvenir des morts dure le plus longtemps, les âmes du purgatoire, étroitement liées au folklore local, et les légendes sur apparitions et fantômes. Dans toute l’Espagne persiste une coutume sacro-sainte qui s’est introduite dans les habitudes culturelles : celle de représenter à cette date une pièce de théâtre liée au mythe de « Don Juan Tenorio ». C’est précisément ce personnage, “le filou de Séville ou l’invité de pierre”, créé par le frère mercédaire et dramaturge espagnol Tirso de Molina, qui a osé se rendre au cimetière cette nuit-là pour évoquer les âmes de ceux qui avaient été victimes de son épée ou de sa possessivité égoïste.
Dans toutes ces représentations, rites et souvenirs, survit un désir inconscient, plutôt païen, d’exorciser la peur de la mort, d’échapper à son angoisse. L’ancien mythe du retour des morts est aujourd’hui devenu des fantômes ou des Draculas à effets spéciaux dans les films d’horreur.
Cependant, pour les croyants, c’est la fête de la Toussaint qui est vraiment pertinente et reflète la foi en l’avenir de ceux qui espèrent et vivent selon l’Évangile prêché par Jésus. C’est ce que soulignait Jean-Paul II dans sa catéchèse du mercredi 28 octobre 1998[2]. Le respect de la dépouille mortelle de ceux qui sont morts dans la foi et de leur mémoire fait partie de la vénération de ceux qui ont été des “temples du Saint-Esprit”.

Comme l’affirme Bruno Forte, professeur à la Faculté de théologie de Naples, contrairement à ceux qui ne croient pas à la dignité personnelle et dévalorisent la vie présente en croyant aux réincarnations futures, le chrétien a « une vision antipode » puisque « la valeur de la personne humaine est absolue. Elle est aussi étrangère au dualisme hérité de Platon qui sépare le corps et l’âme. “Ce dualisme et le mépris conséquent du corps et de la sexualité ne font pas partie du Nouveau Testament pour lequel la personne après la mort continue à vivre tant qu’elle est aimée de Dieu.” Dieu, ajoute le théologien, « n’a pas besoin d’os et d’un peu de poussière pour nous ressusciter. Je veux souligner qu’à une époque de « pensée faible » où l’on prétend que tout tombe toujours dans le néant, il est important d’affirmer la dignité du fragment qu’est chaque vie humaine et son destin éternel »[3].
Miguel A. Fuentes, IVE
Traduction du site : « El Teologo responde »
[1] Zenit, 30 octobre 1998.
[2] https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_28101998.html
[3] Zenit, 30 octobre 1998.