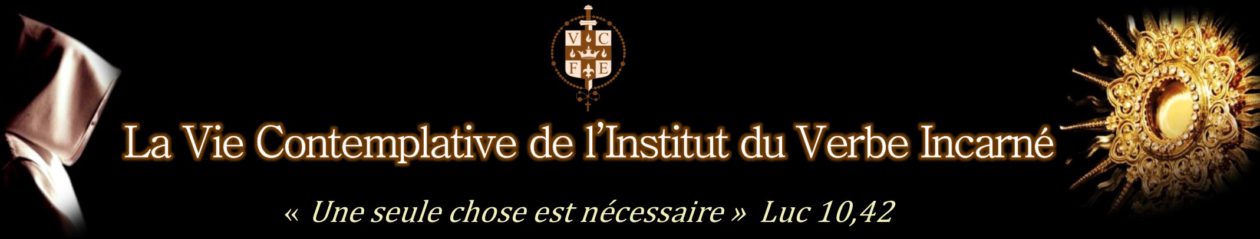Homélie pour le Dimanche IV, année C (Lc 4, 21-30)
L’Évangile d’aujourd’hui — tiré du chapitre 4 de saint Luc —est la continuation de celui de dimanche dernier. Nous nous trouvons encore dans la synagogue de Nazareth, le village où Jésus a grandi et où tous le connaissent. Il lit une prophétie d’Isaïe sur le Messie, et il en annonce l’accomplissement, laissant entendre que cette parole se réfère à Lui, qu’Isaïe a parlé de Lui. Ce fait suscite l’étonnement des Nazaréens : d’une part, « tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche » (Lc 4, 22) ; saint Marc rapporte que beaucoup disaient : « D’où cela lui vient-il ? Et qu’est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée ? » (6, 2). Mais d’autre part, ses concitoyens le connaissent trop bien : « C’est un homme comme nous », disent-ils. « N’est-il pas le fils de Joseph ? » (Lc 4, 22), cela revient à dire : quelles aspirations peut bien avoir un charpentier de Nazareth ?
Pour cette raison, Jésus adresse aux gens des paroles qui résonnent comme une provocation. À ce moment-là, la réaction est unanime : tous se lèvent et le chassent, et ils essaient même de le jeter du haut d’un précipice, mais Lui, avec un calme souverain, traverse la foule furieuse et s’en va.
La question à se poser est presque évidente : comment se fait-il que Jésus ait voulu provoquer cette rupture ? Voici la réponse, Jésus n’est pas venu pour chercher l’approbation des hommes mais, comme il le dira à la fin à Pilate, pour « rendre témoignage à la vérité » (Jn 18, 37).
Le vrai prophète n’obéit à personne d’autre qu’à Dieu et il se met au service de la vérité, même au prix de sa vie. « Il est vrai que Jésus est le prophète de l’amour, mais l’amour a sa vérité. Amour et vérité sont même les deux noms de la même réalité, deux noms de Dieu. Dans la liturgie d’aujourd’hui résonnent aussi ces paroles de saint Paul : « L’amour est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est pas envieux; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, 5 il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne soupçonne pas le mal,; il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il met sa joie dans la vérité » (1 Co 13, 4-6). Croire en Dieu signifie renoncer à ses préjugés et accueillir le visage concret par lequel Il s’est révélé : l’homme Jésus de Nazareth. Et cette voie conduit aussi à le reconnaître et à le servir dans les autres. » (Benoît XVI, 03/02/2013)
Précisément nous allons parler aujourd’hui de la joie dans la vérité donnée comme dit saint Paul par l’authentique charité.
D’abord, le catéchisme nous dit que « La vérité comme rectitude de l’agir et de la parole humaine a pour nom véracité, sincérité ou franchise. La vérité ou véracité est la vertu qui consiste à se montrer vrai en ses actes et à dire vrai en ses paroles, en se gardant de la duplicité, de la simulation et de l’hypocrisie.
La vertu de vérité rend de manière juste à autrui son dû, ce qu’on doit lui donner. La véracité observe un juste milieu entre ce qui doit être exprimé, et le secret qui doit être gardé : elle implique l’honnêteté et la discrétion. En justice, ” un homme doit honnêtement à un autre la manifestation de la vérité ” (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 109, 3).
Le disciple du Christ accepte de ” vivre dans la vérité “, c’est-à-dire dans la simplicité d’une vie conforme à l’exemple du Seigneur et demeurant dans sa Vérité » (CEC. 2468-2470).
Il est vrai que nous ne devons pas juger selon les apparences pour ne pas tomber dans le grand péché des compatriotes de Notre Seigneur, qui ont voulu le tuer ; mais au contraire, nous devons juger dans la vérité les situations, les actions, les comportements, pour chercher la vérité, pour nous éloigner du mal, pour nous aider les uns les autres dans la recherche de la sainteté, de la vie éternelle.
Dans ce sens, nous trouvons des indications précises dans la Sainte Ecriture pour pouvoir juger dans la vérité.
Le célèbre roi sage Salomon dit dans sa prière: « Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? ».
Dans le livre du Deutéronome 16,18-20, il est dit : “Tu établiras des juges et des scribes pour tes tribus dans chacune des villes que le Seigneur te donne ; ils jugeront le peuple avec des jugements justes“. Et le livre des Lévites 19,15 “… tu jugeras ton prochain avec justice”.
Donc, selon la parole de Dieu, dans l’Ancien Testament, il était très commun et très correct de pouvoir « juger » tant que c’est de manière équitable.
Cela nous indique que nous pouvons « juger », porter des jugements justes.
Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs sens :
Juger dans un sens négatif. “Ne jugez pas, pour ne pas être jugé.” Matthieu 7,1
Mais il y a un jugement dans un sens positif. ” Ne jugez pas d’après l’apparence, mais jugez selon la justice.” Jn 7,24 ; cf. 1 Cor 4,1-5.
Il existe aussi le jugement comme discipline interne à l’Eglise, qui correspond à ceux qui ont l’autorité : « Sachez que j’ai déjà jugé le coupable comme s’il était présent… » 1 Co 5,3 « N’est-ce pas vous qui devez juger ceux qui sont à l’intérieur ? 1 Co 5,13
Ainsi saint Paul a porté des jugements et des jugements très durs. 2 Tim 3,8 “De même que Jannès et Jambrès s’opposaient à Moïse, de même ils s’opposent à la vérité. Ces gens ont un esprit corrompu et une foi sans valeur.”
Saint Pierre a jugé et même infligé de sévères châtiments à Ananie et Saphira. Actes 5,1-11
Jésus-Christ lui-même après avoir dit « ne jugez pas », dit en Mt 7,5: ” Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.” Saint Jean-Baptiste a appelé les pharisiens et les sadducéens “race de vipères” (Matthieu 3,7).
Le problème n’est pas de « juger », mais de voir ou de mal juger avec des attitudes pharisaïques ou d’oublier que nous sommes tous des pécheurs.
Il s’agit de juger en tant que discernement chrétien. Comme l’exprime l’auteur de la lettre aux Hébreux 5,14 “Les adultes reçoivent de la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont des sens exercés au discernement du bien et du mal.“
On ne peut pas distinguer, discerner sans avoir préalablement porté un jugement, 1 Tes 5,21 “Examinez tout et gardez ce qui est bon”. Ce n’est qu’en jugeant et en portant des jugements que nous pouvons distinguer le mal et le rejeter pour garder le bien.
Comme règle générale, nous ne devons pas juger par les simples apparences, car cela constitue un jugement téméraire, pour l’éviter, chacun veillera à interpréter autant que possible dans un sens favorable les pensées, paroles et actions de son prochain.
Cela exige de voir la réalité et de savoir discerner le mal du bien, car nous devons agir selon la vérité. Le discernement implique encore de savoir séparer le péché de celui qui commet le péché, qui a besoin de notre miséricorde, de notre pardon, mais aussi d’une conversion, et qu’il arrête de faire le mal qu’il fait, et comme conséquence, nous devons de façon juste et réelle dénoncer le mal, et si c’est de notre domaine, corriger celui qui le fait, comme le supérieur corrige son subalterne, les parents corrigent leurs enfants, les amis ses corrigent par charité. La correction fait partie de la charité, toujours lorsqu’on cherche le bien et le salut du prochain.
Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. La grâce de nous réjouir dans la vérité, fruit de la charité, fruit de l’amour.
P. Luis Martinez IVE.