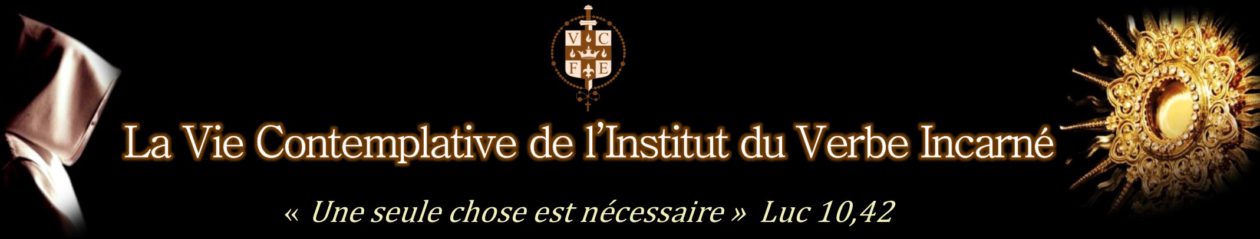Sermon pour le II Dimanche du temps de l’Avent (Mt 3, 1-12)

L’évangile de ce deuxième dimanche de l’Avent a comme sujet principal la prédication de saint Jean Baptiste dans le désert de Judée.
Bien que sa prédication se fît dans un milieu hostile comme le désert de Judée, les gens venaient l’écouter, préparant ainsi leurs cœurs pour la venue de notre Seigneur. C’est la même finalité que poursuit l’Eglise à travers la présentation de la figure emblématique de saint Jean ; elle nous prépare à la célébration de la première Venue du Seigneur.
Et nous constatons que les paroles adressées par Jean à ceux qui venaient à lui n’avaient rien de la politesse « mondaine », pour ainsi dire les mots étaient plutôt durs ; mais certains de ceux qui s’approchaient du Baptiste méritaient de les entendre pour revenir au bon chemin, pour se convertir finalement. Comme c’était le cas des pharisiens et saducéens que Jean Baptiste exhorte à produire un fruit digne de conversion. Selon les paroles du Baptiste, ils voulaient échapper à la colère de Dieu et il fait une bonne comparaison partant du milieu où il se trouve : les serpents s’échappaient du feu qui se produit parfois dans ces régions désertiques et qui, brûlant le peu de végétation sèche – les ronces et les chardons- faisait aussi sortir toutes les bêtes de leurs nids pour fuir le danger.
Nous savons qu’une grande partie de la préparation des cœurs que saint Jean devait accomplir pour la venue du Messie consistait précisément en la mission de « secouer les consciences », comme nous le voyons dans ce passage de l’évangile et comme nous les montrent aussi les autres évangiles.
On vient d’utiliser l’expression « secouer la conscience », et nous savons bien le sens de cette petite phrase pour nous. En effet, nous utilisons beaucoup le mot « conscience » ; nous disons par exemple « examen de conscience » mais aussi des expressions telles que : « agir avec pleine conscience », « sans en avoir conscience », « décharger sa conscience », « respecter la liberté de conscience », « peser sur sa conscience ».

Alors, nous devrions nous poser tout d’abord la question : qu’est-ce que la conscience ?
Le Concile Vatican II (Gaudium et Spes, 16) a défini la conscience comme « le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre ».
Nous donnons le nom de « conscience », en effet, à certains actes accomplis par notre intelligence. C’est par notre intelligence que nous connaissons la réalité, la nature d’une chose (savoir ce qui est), l’utilité (à quoi elle sert), l’origine (d’où elle vient).
Alors, lorsque cette « chose » que notre intelligence connaît sont nos propres actions, nos actes ; autrement dit : lorsque notre raison nous dicte ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait ou ce que nous ferons (elle nous donne une signification), en même temps qu’elle montre aussi la bonté ou la malice d’une action (la valeur), à ce jugement donc de l’intelligence nous lui donnons le nom de « conscience ».

Qu’elle est l’origine de la conscience ? Nous avons tous dans notre cœur une connaissance du bien et du mal, elle est comme imprimée, gravée dans notre âme. L’homme peut reconnaître de manière naturelle que certains actes sont bons et certains, mauvais. Ainsi, Saint Paul dit dans la lettre aux chrétiens de Rome que les païens « qui n’ont pas la Loi (juive) pratiquent spontanément ce que prescrit la Loi, eux qui n’ont pas la Loi sont à eux-mêmes leur propre loi. Ils montrent que la loi est inscrite dans leur cœur, et leur conscience en témoigne. » (cf. Rom 2,14).
La conscience, conclut le Concile Vatican II, est l’intelligence lorsqu’elle découvre cette loi que Dieu a inscrite dans le cœur de l’homme, c’est-à-dire une loi que l’homme n’a pas créée mais à laquelle il doit obéir (cf . Gaudium et Spes, 16)
La conscience accomplit trois fonctions dans notre âme :
Elle est d’abord un témoin de que ce que nous faisons, et de sa bonté ou de sa malice. Comme saint Paul l’écrit aussi aux Romains : « C’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit Saint. » (Rom 9,1)
Elle est un juge, elle approuve ce qui est bien et condamne lorsque nous faisons le mal (« poids de conscience »).
Elle est aussi pédagogue, éducatrice, notre conscience découvre et nous indique le chemin pour agir de façon honnête.
« La conscience — écrit saint Bonaventure — est comme le héraut et le messager de Dieu ; ce qu’elle dit, elle ne le prescrit pas d’elle-même, mais elle le prescrit comme venant de Dieu, à la manière d’un héraut lorsqu’il proclame l’édit du roi. Il en résulte que la conscience a le pouvoir d’obliger » (Veritatis Splendor, 58). Et de cela, Saint Jean Baptiste en est une très bonne image.
La conscience et la Vérité
Dans le passé on donnait aussi à la conscience le nom de « Regula Regulata » ( règle réglée), parce qu’elle a toujours une fonction de médiatrice, elle guide nos actes mais à condition qu’elle soit aussi guidée par quelque chose de plus haut, de supérieur, que nous appelons « Vérité ». Notre conscience doit donc se conformer (« former avec ») à la vérité. Et la vérité se contient en Dieu, parce que Lui est essentiellement (par essence, par nature) la Vérité et Il l’est par excellence. Et Dieu fait participer ses créatures à la Vérité.

Il arrive avec notre conscience ce qui arrive avec un arbitre sportif. Les joueurs doivent respecter ses décisions, mais l’arbitre décidera et dirigera bien un match lorsqu’il appliquera correctement le règlement et ne déformera pas la réalité. Notre conscience est ainsi l’arbitre de nos actes, mais il y a un règlement (une règle, une loi) qui lui est supérieur et notre conscience sera un bon guide lorsqu’elle est fidèle à ce règlement de la Vérité.
Et pour cette raison, l’Ecriture nous répète de rechercher toujours la Vérité et de juger en accord avec la Vérité pour avoir « une conscience pure » (1 Tim. 1,5). Saint Paul dit aussi que notre conscience doit être « illuminée par l’Esprit Saint » (Rom. 9,1), « pure » (2 Tim. 1 ,3), elle ne doit pas falsifier la parole de Dieu, au contraire, la conscience doit manifester la vérité. D’ailleurs, l’apôtre encourage les chrétiens en disant : « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait » (Rm 12, 2). (cf. Veritatis Splendor, 62)
Et ma conscience peut-elle se tromper ?
Il y a un deuxième aspect qu’il faut prendre en compte par rapport à la conscience, c’est la possibilité qu’elle puisse se tromper. Notre conscience n’est pas infaillible (Veritatis Splendor, 62), et la raison en est qu’elle est un acte de notre intelligence, qui est créée, faillible, blessée par le péché et influençable (comme il peut arriver au travers d’une éducation contraire aux principes de la foi chrétienne que les enfants peuvent recevoir à l’école).

Il est vrai que La conscience nous délivre toujours des jugements pratiques : « comment agir » et par exemple elle m’indique de changer de vie si j’ai tort, elle me dit parfois d’accomplir une obligation malgré les sacrifices que cela me coûterait. Mais les jugements de la conscience sont toujours menacés d’être affectés par nos passions, nos inclinaisons personnelles, nos habitudes, nos goûts (nos plaisirs) et ils vont pousser à corrompre ma conscience en m’inclinant vers ce que ma sensibilité a envie de choisir ou d’éviter.
Il faut donc, qu’au-delà de tous ces penchants de ma nature affectée par le péché, je reconnaisse dans ma conscience la réalité des choses, que je m’ajuste au plan de Dieu pour qu’elle atteigne sa véritable dignité, car notre conscience est créée pour servir la vérité.
Lorsque quelqu’un falsifie la vérité ou l’ignore par sa propre négligence, lorsqu’il n’a pas suffisamment d’amour pour la vérité ou la vertu ; ou bien si une personne ne fait aucun effort pour éduquer la conscience ou l’éclairer sur certains aspects, cette personne ne pourra jamais s’excuser commettre un péché tout en disant « je suis ma conscience ».
Saint Jean Paul II disait : « Il ne suffit donc pas de dire à l’homme : Obéis toujours à ta conscience. Il est nécessaire d’ajouter immédiatement : Demande-toi si ta conscience dit le vrai ou le faux, et cherche, sans te lasser, à connaître la vérité » (Audience. 17/8/83)
Finalement, comment pouvons-nous éduquer notre conscience ?
Nous avons dit que nous avons l’obligation d’éduquer notre conscience, de la former afin que nos jugements soient toujours vrais. Essentiellement, il s’agit de deux aspects :

Premièrement, il est nécessaire de vivre de façon vertueuse, rechercher la vertu. Cela nous éloigne de tout péché.
Deuxièmement, illuminer notre conscience sur le bien et sur la vérité. Ce qui se réalise à travers la foi, la parole de Dieu et l’enseignement authentique de l’Eglise (le magistère deux fois millénaire). Le pape Jean Paul II disait aux évêques de France « les pasteurs doivent former les consciences, appelant bon ce qui est bon et mauvais ce qui est mauvais » (Discours, 15/3/87) et cela vaut pour tous les chrétiens.
Lorsqu’il s’agit surtout de nous former aux aspects concernant la doctrine de l’Eglise, sur des questions de foi et de morale, nous devons nous éclairer toujours pour éviter d’agir contre ce que l’Eglise nous commande.
Demandons la grâce à Saint Jean Baptiste et la très Sainte Vierge Marie, de toujours garder pure notre conscience, recherchant la Vérité, la grâce d’éveiller en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir Notre Seigneur Jésus-Christ.
P. Luis Martinez IVE.

Nous ajoutons à cette homélie les belles paroles adressées par saint Thomas More à sa fille; ce saint anglais, à qui nous pouvons donner le titre de martyr de la bonne conscience, écrivait depuis sa prison :
«Certains croient que, s’ils parlent d’une façon et pensent d’une autre, Dieu aura plus d’attention à leur cœur qu’à leurs lèvres, écrit-il à sa fille Marguerite. Pour moi, je ne puis agir comme eux en une matière aussi importante : je n’omettrais pas le serment si ma conscience me dictait de le faire, même si les autres le refusaient ; et tout autant, je ne le prêterais pas contre ma conscience, même si tout le monde y souscrivait»
Pour savoir plus sur la vie de saint Thomas More :