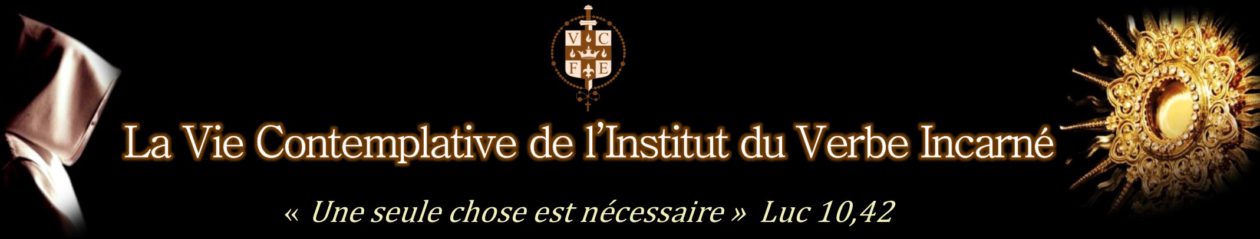Baptême du Seigneur
Le dernier mystère que l’Eglise propose à notre méditation pour le temps de Noël et qui se conclut aussi avec ce temps c’est le Baptême du Seigneur. Il est aussi le mystère qui inaugure sa vie publique, c’est-à-dire qu’à partir de son baptême le Seigneur commencera la prédication et l’invitation à la conversion, la réalisation des miracles et la formation de l’Eglise ; cette vie publique durera environ trois ans, jusqu’à sa passion, son sacrifice sur la Croix, sa mort et sa résurrection.
Saint Ambroise enseigne que Notre-Seigneur a voulu être baptisé, non pour se purifier, lui qui n’a pas connu le péché, mais pour communiquer aux eaux, par le contact de sa chair immaculée, la vertu de purifier les hommes dans le baptême.
« Notre-Seigneur, s’exprime le même Père de l’Eglise, dans un autre commentaire, nous apprend d’ailleurs lui-même pourquoi il voulut recevoir le baptême, quand il dit: «C’est ainsi qu’il nous faut accomplir toute justice». Or, en quoi consiste la justice? à commencer par faire ce que vous voulez qu’on vous fasse à vous-même et à donner le premier l’exemple. Que personne donc ne se refuse à recevoir le baptême de la grâce, quand Jésus-Christ n’a pas dédaigné de recevoir le baptême de la pénitence.
Cela nous conduit à traiter, encore une fois, car cela revient toujours, de l’obligation de tous les chrétiens, les catholiques de parvenir au baptême et, ce qui est aussi une grande responsabilité devant Dieu, d’aider les enfants à recevoir la grâce du baptême, de ne pas les empêcher de recevoir ce don qui n’a pas de prix.
Certains pensent, et là nous devons malheureusement y inclure même certains pasteurs de l’Eglise, que le baptême des petits enfants est un affront à la liberté de la personne. Que tout chrétien devrait lui-même demander le baptême et non les parents le faire pour leurs enfants, car cela ferait violence à la liberté de ces derniers.
Comment l’Eglise répond-elle à cette objection ? Ecoutons donc le magistère, nous allons suivre quelques paragraphes d’un document qui parle précisément du baptême des enfants.
« Bien des parents, en effet, sont angoissés de voir leurs enfants abandonner la foi et la pratique sacramentelle malgré l’éducation chrétienne qu’ils se sont efforcés de leur donner, et des pasteurs se demandent s’ils ne devraient pas être plus exigeants avant de baptiser les tout-petits. Certains estiment préférable de différer le baptême des enfants jusqu’au terme d’un catéchuménat de plus ou moins longue durée, tandis que d’autres demandent que l’on réexamine, au moins à l’égard des tout-petits, la doctrine de la nécessité du baptême, et souhaitent que l’on renvoie sa célébration à l’âge où est possible un engagement personnel, fût-ce même au seuil de l’âge adulte.
Mais, nous devons savoir que le baptême des enfants était une pratique depuis les origines de l’Eglise, pratiquée par les apôtres ; nous entendons cela lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, que les maisons (voire les familles) se convertissaient à la totalité et tous recevaient à ce moment le baptême :
« En Orient comme en Occident, la pratique de baptiser les petits enfants est considérée comme une norme de tradition immémoriale. Origène, puis plus tard saint Augustin, y voient une ” tradition reçue des apôtres “. Le plus ancien rituel connu, celui que décrit au début du troisième siècle la Tradition apostolique, contient la prescription suivante: ” On baptisera en premier lieu les enfants; tous ceux qui peuvent parler pour eux-mêmes parleront; quant à ceux qui ne le peuvent pas, leurs parents parleront pour eux ou quelqu’un de leur famille. ” Saint Cyprien, tenant un Synode avec les évêques d’Afrique, affirmait ” qu’il ne faut refuser la miséricorde et la grâce de Dieu à aucun homme venant à l’existence “; et ce même Synode, rappelant ” l’égalité spirituelle ” de tous les hommes, quels que soient ” leur taille et leur âge “, décréta que l’on pouvait baptiser les enfants ” dès le deuxième ou le troisième jour après leur naissance.”
Certes, reconnait aussi ce document, la pratique du baptême des enfants a connu une certaine régression an cours du quatrième siècle. A cette époque, où les adultes eux-mêmes différaient leur initiation chrétienne, dans l’appréhension des fautes à venir et la crainte de la pénitence publique, bien des parents renvoyaient le baptême de leurs enfants pour les mêmes motifs. Mais on doit également constater que des Pères et des Docteurs comme Basile, Grégoire de Nysse, Ambroise, Jean Chrysostome, Jérôme, Augustin – eux-mêmes baptisés à l’âge adulte en raison de cet état de choses -, réagirent ensuite avec vigueur contre une telle négligence, demandant instamment aux adultes de ne pas retarder le baptême nécessaire au salut, et plusieurs d’entre eux insistent pour qu’il soit conféré aux petits enfants.
Considérons aussi que le Concile de Carthage de 418 condamne ” ceux qui nient qu’on doive baptiser les petits enfants récemment sortis du sein maternel “, et affirme que « en raison de la règle de foi ” de l’Église catholique concernant le péché originel, ” même les tout-petits, qui n’ont pu commettre encore personnellement aucun péché, sont baptisés véritablement pour la rémission des péchés, afin que soit purifié par la régénération ce qu’ils tiennent de leur naissance ».
Aussi, après donc avoir vu ce que l’Eglise a fait et enseigné depuis longtemps par rapport à la réception du baptême par les enfants, abordons maintenant les autres arguments que nous présente l’Eglise dans l’actualité :
Le baptême est manifestation de l’amour prévenant du Père, participation au mystère pascal du Fils, communication d’une vie nouvelle dans l’Esprit ; il fait entrer les hommes dans l’héritage de Dieu et les agrège au Corps du Christ qui est l’Église.
Dans une telle perspective, l’avertissement du Christ dans l’évangile selon saint Jean: ” Personne, à moins de renaître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu ” (Jn. 3,8), doit être perçu comme l’invitation d’un amour universel et sans bornes; ce sont les paroles d’un Père qui appelle ses enfants et veut pour eux le plus grand des biens.
L’Église doit ensuite répondre à la mission donnée par le Christ aux apôtres après sa résurrection et rapportée dans l’évangile selon saint Matthieu sous une forme particulièrement solennelle : ” Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre; allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.”
Le fait que les petits enfants ne puissent pas encore professer personnellement leur foi n’empêche pas l’Église de leur conférer ce sacrement car, en réalité, c’est dans sa foi à elle qu’ils sont baptisés. Ce point doctrinal était déjà clairement fixé par saint Augustin : « Les petits enfants, écrivait-il, sont présentés pour recevoir la grâce spirituelle, non pas tellement par ceux qui les portent dans leurs bras (quoique ce soit aussi le cas s’ils sont de bons fidèles) que par la société universelle des saints et des fidèles […] C’est la Mère Église tout entière, celle qui est dans ses saints, qui agit, car c’est elle qui tout entière les enfante, tous et chacun. » Il faut souligner en saint Augustin, la comparaison qu’il fait entre une mère humaine et l’Eglise, les deux enfantent, et nous pouvons penser que la mère pour donner la vie à un enfant, n’attaque pas la liberté de ce dernier, au contraire, elle donne la possibilité qu’il naisse et le fait de priver de la vie serait pour l’enfant un acte contre sa liberté et sa personne commis par la même mère.
Une autre objection : On dit encore que toute grâce, puisqu’elle s’adresse à une personne, doit être consciemment accueillie et faite sienne par celui qui la reçoit, ce dont le petit enfant est bien incapable.
Et voici la réponse : En réalité, l’enfant est une personne bien avant qu’il soit en mesure de le manifester par des actes de conscience et de liberté, et comme tel, il peut déjà devenir par le sacrement de baptême fils de Dieu et cohéritier du Christ. Sa conscience et sa liberté pourront ensuite, dès leur éveil, disposer des énergies déposées dans son âme par la grâce baptismale.
On objecte aussi au baptême des petits enfants qu’il constituerait une atteinte à leur liberté. Ce serait contraire à leur dignité de personne que de leur imposer pour l’avenir des obligations religieuses que, plus tard peut-être, ils seront amenés à récuser. Mieux vaudrait ne conférer le sacrement qu’à l’âge où l’engagement libre est devenu possible. En attendant, parents et éducateurs devraient se tenir sur la réserve, et s’abstenir de toute pression.
Mais une telle attitude est bien illusoire : il n’existe pas de pure liberté humaine, qui serait exempte de tout conditionnement. Déjà au plan naturel, les parents font pour leur enfant des choix indispensables à sa vie et à son orientation vers les vraies valeurs. Une attitude soi-disant neutre de la famille à l’égard de la vie religieuse de l’enfant serait en fait une option négative, que le priverait d’un bien essentiel. Surtout, quand on prétend que le sacrement de baptême compromet la liberté de l’enfant, on oublie que tout homme, même non baptisé, a envers Dieu comme créature des obligations imprescriptibles, que le baptême vient ratifier et élever dans l’adoption filiale. On oublie aussi que le Nouveau Testament nous présente l’entrée dans la vie chrétienne non comme une servitude ou une contrainte, mais comme l’accès à la vraie liberté.
La pratique du baptême des enfants est en fait, authentiquement évangélique, car elle a une valeur de témoignage ; elle manifeste en effet la prévenance de Dieu et la gratuité de l’amour qui enveloppe notre vie: ” Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés… Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Jn 4,10.19.” Même chez l’adulte, les exigences qu’entraîne la réception du baptême ne doivent pas faire oublier que ” ce n’est pas à cause d’actes méritoires que nous aurions accomplis, mais dans sa miséricorde, que Dieu nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouveau de l’Esprit-Saint “ Tt 3, 5.
Comme conclusion, la grande erreur et la confusion de beaucoup dans nos jours trouve sa racine dans la mauvaise conception de la liberté dans la foi, non seulement comme un ensemble de droits et d’obligations, mais comme un don de Dieu qui répond à son grand amour pour nous et à sa Miséricorde, qui s’adresse à tous les hommes de tout âge et toute culture, car son amour n’a pas de limites : Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Cette vie commence précisément par le baptême.
Que Marie nous donne cette grâce, la grâce d’accueillir la vie que son Fils nous donne.
P. Luis Martinez IVE.
Instruction Pastoralis Actio, sur le baptême des petits enfants